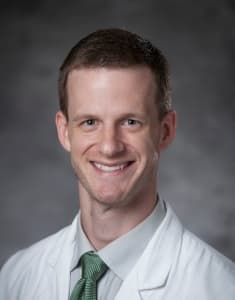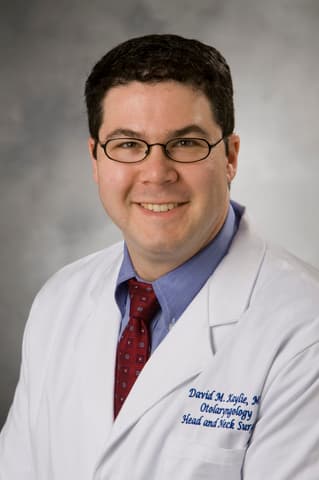Réparation transmastoïdienne de la déhiscence du canal semi-circulaire supérieur
Main Text
Table of Contents
La déhiscence du canal semi-circulaire est associée à une surdité de transmission, à l’autophonie et au vertige induit par la pression ou le son. Les patients symptomatiques peuvent choisir de subir une intervention chirurgicale. L’approche transmastoïdienne offre la possibilité d’une procédure ambulatoire pour exposer et boucher le canal autour du défaut.
Les patients atteints de déhiscence du canal semi-circulaire supérieur (SSCD) peuvent présenter une variété de symptômes. Plusieurs symptômes se chevauchent avec d’autres syndromes otologiques et vasculaires, et doivent être distingués de la SSCD par une anamnèse détaillée et un examen physique. Depuis la première description de ses manifestations par Minor1 , les méthodes de diagnostic et les traitements ont considérablement évolué.
Les symptômes comprennent souvent l’autophonie, la pression auditive, les symptômes vestibulaires induits par le bruit ou les changements de pression, les acouphènes pulsatiles et la perte auditive.
À l’examen physique, la membrane tympanique et l’espace de l’oreille moyenne du patient peuvent sembler normaux. Lors de l’induction de sons forts ou de changements de pression (otoscopie pneumatique), les patients peuvent ressentir un nystagmus vertical et de torsion aligné avec le canal supérieur. 2 Dans les cas de surdité de transmission, un diapason démontrera une conduction osseuse supérieure à la conduction aérienne dans l’oreille affectée, et une latéralisation à l’oreille affectée à l’examen Weber.
Des études supplémentaires sont essentielles dans le diagnostic de la SSCD. L’autophonie est présente chez les patients atteints de trompe d’Eustache patule et de nombreuses affections de l’oreille moyenne entraînent une perte auditive de transmission. Une tomodensitométrie (TDM) à haute résolution de l’os temporal doit être obtenue pour déterminer la quantité d’os recouvrant le canal supérieur. Lors de la commande de ces essais, il est important de préciser l’orientation des reconstructions dans le plan du canal ainsi que perpendiculairement à ce plan. Les potentiels myogéniques évoqués vestibulaires (VEMP) peuvent également aider au diagnostic. Les seuils permettant d’obtenir une réponse dans le test VEMP cervical sont plus bas dans l’oreille affectée par rapport à une oreille normale.
Un audiogramme peut mettre en évidence une perte auditive de transmission. Une distinction importante est la présence de lignes de conduction osseuse supraseuil.
Le diagnostic de SSCD peut être une découverte fortuite d’une TDM obtenue dans un but sans rapport. Les patients peuvent être asymptomatiques ou présenter l’un des symptômes mentionnés précédemment en combinaison. Pour les patients asymptomatiques ou non gênés par les symptômes, l’observation peut être appropriée. Pour ceux qui présentent des symptômes plus gênants ou débilitants, plusieurs options chirurgicales existent.
Si les symptômes primaires sont induits par la pression (phénomène de Tullio), la mise en place d’une sonde de tympanostomie peut être utile. Pour d’autres, un resurfaçage du canal via une craniotomie de la fosse moyenne ou un bouchage par la même approche ou par mastoïdectomie peut être nécessaire.
Dans ce cas, la patiente était très gênée par son autophonie, étant donné qu’elle devait parler fréquemment au travail. Elle avait également des étourdissements provoqués par l’effort (Valsalva contre une glotte fermée). Lorsque le diagnostic a été confirmé, les options d’observation, de thérapie vestibulaire et d’intervention chirurgicale ont été discutées. L’approche de la fosse crânienne moyenne et l’approche transmastoïdienne ont été discutées avec les avantages et les inconvénients de chacune. Étant donné la nature ambulatoire de l’intervention transmastoïdienne et le préjudice important que ses symptômes ont causé à la qualité de vie, la patiente a choisi de procéder.
Chez les patients plus âgés, une craniotomie de la fosse moyenne avec rétraction du lobe temporal peut présenter un risque plus élevé que chez les patients plus jeunes. De plus, les patients subissant une craniotomie de la fosse moyenne nécessitent souvent un drainage lombaire et une hospitalisation. À l’inverse, l’approche transmastoïdienne offre la possibilité d’une procédure ambulatoire. Les patients doivent être informés des risques spécifiques de la procédure, notamment les lésions du nerf facial et la perte auditive transitoire ou permanente.
Anesthésie générale, intubation endotrachéale et évitement de tout relaxant musculaire à action prolongée en raison de la nécessité d’une surveillance des nerfs faciaux tout au long de la procédure.
Le patient est placé en décubitus dorsal, la tête tournée vers l’extérieur. Les bras sont repliés et le brassard de tensiomètre doit être placé sur le bras opposé au côté chirurgical. Le lit est tourné à 180 degrés à l’écart de l’anesthésie.
La surveillance du nerf facial bicanal est utilisée.
Un gommage et une solution standard à la bétadine sont utilisés.
Une incision postauriculaire standard est pratiquée à environ 5 à 10 mm en arrière du sillon postauriculaire. Après avoir divisé la peau et le tissu sous-cutané, le fascia temporo-pariétal est rencontré. En profondeur, un plan avasculaire superficiel au fascia temporal est ouvert et porté au niveau du conduit auditif externe. Supérieurement, la dissection est ouverte plus en avant sur la racine du zygoma. Le fascia temporal peut être récolté, pressé et mis de côté pour sécher. Une incision périostée est ensuite pratiquée le long de la ligne temporale. Une incision en forme de « T » ou de « 7 » est pratiquée en disectant la pointe mastoïdienne. Le périoste est élevé vers le haut, vers l’arrière, puis vers l’avant pour exposer la colonne vertébrale de Henle. Ensuite, une mastoïdectomie doit être effectuée, délimitée par le tegmen en haut, le sinus sigmoïde en arrière et le conduit auditif en avant. Au cours du forage, le chirurgien peut recueillir la poussière osseuse pour l’utiliser comme pâté pour occlure le canal plus tard dans la procédure. Lorsque l’antre est ouvert, le canal semi-circulaire latéral et le processus court de l’incus doivent être identifiés. Ensuite, le nerf facial peut être exposé distalement au deuxième genu et le long du segment descendant. Il n’a pas besoin d’être décompressé ou exposé au foramen stylomastoïdien. Avec le tegmen et le canal semi-circulaire latéral exposés, le canal supérieur des crus communs est situé. Il est tracé vers le haut et vers l’avant pour découvrir tout son parcours. Il est important de comprendre l’anatomie du canal supérieur par rapport aux autres canaux semi-circulaires et à la crête pétreuse. Un « Blue-lining » du canal est ensuite effectué. La surface latérale du canal est soigneusement amincie jusqu’à ce que l’endosteum soit exposé. Il est essentiel d’effectuer cette étape avec soin, car la violation du labyrinthe membraneux peut entraîner une perte auditive neurosensorielle profonde. Certains chirurgiens alignent en bleu de petites zones vers l’avant (juste à proximale de l’extrémité apullée) et postérieurement (juste distale par rapport aux crus communs) pour le bouchage. D’autres exposeront l’ensemble du canal, garantissant ainsi que l’occlusion se produit autour du défaut dans le tegmen. Ensuite, le pâté d’os est soigneusement emballé en avant et en arrière du défaut (en cas d’exposition limitée) ou le long du canal. La cire d’os peut être doucement pressée sur ces zones à l’aide d’un cotonoïde humidifié. Alternativement, le fascia précédemment récolté peut être coupé et rentré sur le pâté d’os. Un petit morceau de Gelfoam peut ensuite être déposé sur le canal.
Le périoste est fermé de manière interrompue à l’aide d’une suture en vicryl 3-0. Le premier point de suture est généralement lancé pour se rapprocher du lambeau de Palva avec l’aspect le plus postéro-supérieur de l’incision périostée. Après la fermeture du périoste, la couche dermique profonde est également fermée de manière interrompue à l’aide d’une suture Monocryl 4-0.
La plaie est pansée avec des Steri-Strips après l’application de benjoin ou de mastisol, suivie d’un pansement Glasscock ou d’un pansement compressif mastoïdien.
Les patients sont informés de ce qui suit
- Gardez la tête du lit élevée à 30 degrés pendant 48 à 72 heures après la chirurgie.
- Pas de mouchage.
- N’essayez pas d’étouffer la toux ou les éternuements, faites-le avec la bouche ouverte.
- Ne prenez pas de douche pendant 48 heures. À ce stade, le patient peut prendre une douche, mais ne doit laisser couler que de l’eau et du savon sur l’incision, sans frotter. Il doit être séché en tapotant doucement la zone.
- Les Steri-Strips peuvent commencer à se décoller et à tomber, mais ils doivent être laissés en place jusqu’à ce qu’ils soient retirés par le chirurgien.
- La douleur postopératoire est prise en charge avec de l’ibuprofène, des comprimés de 600 mg toutes les 6 heures au besoin, à condition que le patient ne présente pas d’effets indésirables ou d’antécédents d’ulcère gastrique.
- Si des narcotiques sont fournis, les patients doivent prendre un émollient fécal pour éviter tout effort pendant les selles.
- Ne soulevez pas plus de 10 à 15 livres pendant 2 semaines après la chirurgie.
Des instructions postopératoires standard concernant la fièvre, la gestion de la douleur et les signes avant-coureurs sont fournies avec des numéros de téléphone au cabinet et à l’hôpital pour joindre un médecin à tout moment.
Un suivi pour un contrôle de la plaie doit avoir lieu 1 à 2 semaines après la chirurgie.
Un audiogramme est réalisé 3 mois après l’intervention.
- Plateau d’oreille microscopique standard
- Système de perçage avec coupe et fraises diamantées
- Système de surveillance du nerf facial
L’auteur C. Scott Brown travaille également comme rédacteur en chef de la section Oto-rhino-laryngologie du Journal of Medical Insight.
Le patient visé dans cet article vidéo a donné son consentement éclairé pour être filmé et est conscient que des informations et des images seront publiées en ligne.
References
- Syndrome de déhiscence du canal supérieur. Am J Otol. 2000; 21(1):9-19.
- Cremer, Minor LB, Carey JP, Della Santina CC. Les mouvements oculaires chez les patients atteints du syndrome de déhiscence du canal supérieur s’alignent sur le canal anormal. Neurologie. 2000; 55(12):1833-41. doi :10.1212/wnl.55.12.1833.
Cite this article
Brown CS, Kaylie DM. Réparation transmastoïdienne de la déhiscence du canal semi-circulaire supérieur. J Med Insight. 2023; 2023(248). doi :10.24296/jomi/248.