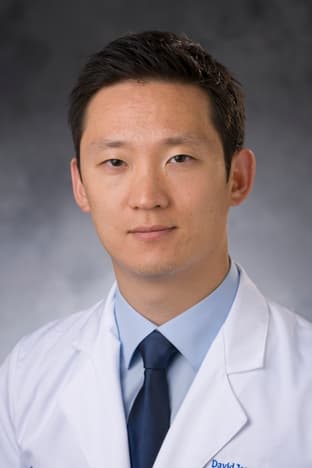Chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus : maxillaire, ethmoïde et sphénoïde (cadavre)
Main Text
Table of Contents
La chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus (FESS) est une technique mini-invasive largement adoptée depuis les années 1980 pour la prise en charge des affections sinusales telles que la rhinosinusite chronique et la polypose nasale. Cet article présente un guide vidéo cadavérique détaillé de la FESS, illustrant la dissection étape par étape des sinus maxillaire, ethmoïdal et sphénoïdal. L’accent est mis sur les repères anatomiques, la technique chirurgicale et l’évitement des complications. Destiné principalement aux résidents et aux praticiens en début de carrière, le guide vise à améliorer les compétences chirurgicales, à promouvoir la pratique normalisée et, en fin de compte, à améliorer les résultats pour les patients en chirurgie sinusale.
La chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus (FESS), mise au point dans les années 1980, est devenue l’approche standard pour la prise en charge chirurgicale de diverses affections sinuso-nasales, telles que la rhinosinusite chronique et la polypose nasale. 1 Cette technique peu invasive implique l’utilisation d’un endoscope pour visualiser et accéder aux sinus paranasaux, ce qui permet une ablation précise et ciblée des tissus malades. La FESS a démontré des résultats supérieurs à ceux des approches chirurgicales conventionnelles. Le taux de récidive de la polypose nasale après FESS est nettement plus faible (6,67 % des cas), contre un taux de récidive de 30 % après une chirurgie conventionnelle. 2 De plus, l’utilisation de la FESS a entraîné une diminution notable de 15 % de la durée de la chirurgie de rhinosinusite frontale par rapport à la chirurgie ouverte traditionnelle. 3
La rhinosinusite chronique, en particulier, est une maladie sinusale prévalente et débilitante, affectant entre 5 % et 12 % de la population générale. 4 Cette maladie inflammatoire chronique peut altérer considérablement la qualité de vie, entraînant des symptômes tels que la congestion nasale, des douleurs faciales, des maux de tête et un dysfonctionnement olfactif. 5 Dans les cas où la prise en charge médicale conventionnelle, y compris l’utilisation de corticostéroïdes intranasaux et d’antibiotiques, ne parvient pas à apporter un soulagement durable aux patients présentant des symptômes de la maladie, la FESS apparaît comme une intervention pivot, visant à rétablir le drainage et la ventilation normaux des sinus par l’élimination ciblée des tissus malades ou obstructifs. 6
Les complications potentielles associées à la FESS sont les suivantes : lésion directe du cerveau, vision double, lésions du canal lacrymal/déchirure excessive, hématome dans l’orbite, formation de synéchies, lésions de l’artère carotide, lésions du nerf optique, lésions de l’orbite et fuite de liquide céphalo-rachidien.
Dans une étude rétrospective complète de la chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus, le taux global de complications s’est avéré être de 0,50 %. Les taux de transfusion sanguine, de syndrome de choc toxique, d’hémorragie nécessitant une intervention chirurgicale, de fuite de liquide céphalo-rachidien et de lésions orbitaires étaient respectivement de 0,18 %, 0,02 %, 0,10 %, 0,09 % et 0,09 %. 7
La vidéo cadavérique sur la FESS présentée ici offre un guide détaillé et complet sur la dissection du sinus maxillaire, ethmoïdal et sphénoïdal. L’approche étape par étape, couplée à l’accent mis sur les considérations anatomiques, fait de cette vidéo une ressource essentielle pour les professionnels de la santé impliqués dans la prise en charge des troubles sinuso-nasaux.
La procédure commence par le placement approprié de la tête cadavérique et la configuration de l’instrument. La tête cadavérique est positionnée de manière à être utilisée lors de l’intervention chirurgicale proprement dite, la tête légèrement tournée vers le chirurgien. La hauteur de la table est ajustée de manière à ce que le bras du chirurgien puisse reposer confortablement sur le torse, minimisant ainsi la fatigue.
La visualisation initiale avec un endoscope à angle de vue de 0 degré permet d’identifier les principales structures sinusales, y compris le cornet inférieur, le septum et le cornet moyen. Bien que le cornet moyen soit évident chez la plupart des patients, il peut être difficile à identifier dans la polypose nasale sévère. Dans de tels cas, il peut être plus facilement identifié plus haut à son site de fixation. Pour la première étape de l’opération, l’élévateur périosté à double extrémité est utilisé pour déplacer doucement le cornet moyen médialement. Cette manœuvre est exécutée avec prudence pour éviter l’apparition d’une fracture de la base du crâne et d’une fuite de liquide céphalo-rachidien (LCR) qui en résulte. Au fur et à mesure que la médialisation progresse, le processus unciné devient évident, ainsi que la bulle ethmoïde et la lamelle basale située postérieurement derrière la bulle ethmoïde.
L’étape suivante de la procédure implique l’ablation du processus d’oncination, connu sous le nom d’uncincectomie. La sonde à angle droit est utilisée pour accéder à la face postérieure de l’unciné, facilitant sa fracture antérieure. Après la mobilisation, l’unciné est divisé par le bas à l’aide d’une pince de médisance, ce qui permet un retrait précis. Ensuite, le microdébrideur est utilisé pour éliminer les restes résiduels du processus d’onciné. Une fois l’oncinéctomie terminée, l’étape suivante consiste à localiser l’ostium naturel du sinus maxillaire. L’ostium naturel est généralement situé à la jonction entre le cornet moyen inférieur, positionné derrière l’apophyse uncinaire. Une fois l’entrée réussie, une dilatation douce du sinus maxillaire est effectuée pour améliorer la visibilité à l’intérieur de sa cavité. En utilisant le microdébrideur, le sinus maxillaire est encore élargi, en particulier dans les cas où un os épais obstrue l’accès. Dans de tels cas, la pince coupante droite peut être introduite pour faciliter l’ouverture supplémentaire du sinus maxillaire, en particulier inférieur.
À la fin de l’antrostomie maxillaire, l’ouverture naturelle est vérifiée à l’aide d’une sonde. Les retours sensoriels, tels que la palpation du toit du sinus et l’identification de la transition vers la lamina papyracea, aident à confirmer l’emplacement de l’ostium. L’étape suivante comprend l’ablation de l’ethmoïde bulle. Initialement, une curette en forme de J est utilisée pour palper la présence de la cavité rétrobullaire, dont la proéminence peut varier d’un individu à l’autre. Des efforts sont faits pour accéder à cette cavité, bien qu’à l’occasion, une entrée directe dans la bulle ethmoïdale puisse se produire. Dans de tels cas, une fracture antérieure de la bulle est exécutée. L’ablation de la bulle est facilitée à l’aide d’une pince coupante, assurant une exérèse complète. Le processus se poursuit jusqu’à ce que l’ethmoïde bulle soit complètement éliminée du champ opératoire.
Suite à l’excision de la bulle ethmoïdale, la lame papyracée est exposée latéralement. Par la suite, la lamelle basale est identifiée au niveau correspondant. L’entrée dans la lamelle basale permet d’accéder à la cavité ethmoïdale postérieure, où les cloisons sont méticuleusement enlevées à l’aide d’un microdébrideur et d’une pince pour un dégagement complet. Pour amorcer la sphénoïdotomie, la partie inférieure du cornet supérieur est réséquée, créant ainsi un espace pour un accès ultérieur. Après la résection des cornets, l’attention est dirigée vers la localisation de l’ostium du sinus sphénoïdal. Ensuite, il est dilaté et élargi latéralement pour visualiser l’intérieur du sinus. Une ethmoïdectomie postérieure-antérieure s’ensuit, squelettisant la base du crâne tout en supprimant les cloisons dans le sinus sphénoïdal. Enfin, un endoscope incliné permet de dissectionner l’évidement frontal, complétant ainsi la FESS.
Il est crucial d’être conscient des cellules d’air d’Onodi. Ces cellules sont généralement asymptomatiques mais sont situées dangereusement près du nerf optique et de l’artère carotide interne, avec une séparation osseuse minimale. L’identification erronée de la paroi postérieure de ces cellules comme étant le sinus sphénoïdal lors de l’entrée endoscopique peut potentiellement endommager ces structures critiques. Par conséquent, une identification précise et une navigation prudente autour de ces cellules sont essentielles pendant la FESS pour prévenir les complications. 8
Dans l’ensemble, ce guide vidéo cadavérique complet sur la FESS est une ressource éducative essentielle qui peut contribuer à normaliser les pratiques chirurgicales, à améliorer la compétence des chirurgiens et, en fin de compte, à optimiser la qualité des soins pour les patients atteints de troubles sinusaux.
Le Dr Scott Brown est rédacteur en chef de section chez JOMI et n’a pas participé au traitement éditorial de cet article.
Résumé ajouté après publication le 31/07/2025 pour répondre aux exigences d’indexation et d’accessibilité. Aucune modification n’a été apportée au contenu de l’article.
Découvrez le reste de la série ci-dessous :
References
- Bunzen DL, Campos A, Leão FS, Morais A, Sperandio F, Neto SC. Efficacité de la chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus pour les symptômes de la rhinosinusite chronique avec ou sans polypose. Braz J Oto-rhino-laryngol. 2006; 72(2). doi :10.1016/s1808-8694(15)30062-8.
- Humayun MP, Alam MM, Ahmed S, Salam S, Tarafder KH, Biswas AK. Etude comparative des résultats de la chirurgie endoscopique des sinus et de la chirurgie conventionnelle de la polypose nasale. Mymensingh Med J. 2013 ; 22(1).
- Alekseenko S, Karpischenko S. Analyse comparative des résultats de la chirurgie externe et endoscopique du sinus frontal chez les enfants. Acta Otolaryngol. 2020; 140(8). doi :10.1080/00016489.2020.1752932.
- Fokkens WJ, Lund VJ, Mullol J, et al. EPOS 2012 : Document de position européen sur la rhinosinusite et les polypes nasaux 2012. Un résumé pour les oto-rhino-laryngologistes. Rhinologie. 2012 ; 50(1). doi :10.4193/rhino50E2.
- Hoehle LP, Philips KM, Bergmark RW, Caradonna DS, Gray ST, Sedaghat AR. Les symptômes de la rhinosinusite chronique ont un impact différentiel sur la qualité de vie liée à la santé générale. Journal de rhinologie. 2016; 54(4). doi :10.4193/rhin16.211.
- Rosenfeld RM, Piccirillo JF, Chandrasekhar SS, et al. Guide de pratique clinique (mise à jour) : sinusite chez l’adulte. Otolaryngol Chirurgie du cou de la tête 2015;152. doi :10.1177/0194599815572097.
- Suzuki S, Yasunaga H, Matsui H, Fushimi K, Kondo K, Yamasoba T. Taux de complications après une chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus : analyse de 50 734 patients japonais. Laryngoscope. 2015; 125(8):1785-1791. doi :10.1002/lary.25334.
- Gaillard F, Hacking C, Ranchod A, et al. Cellule aérienne sphénoethmoïdale. Article de référence, Radiopaedia.org. Consulté le 19 mai 2024. doi :10.53347/rID-1776.
Cite this article
Brown CS, Jang DW. Chirurgie endoscopique fonctionnelle des sinus : maxillaire, ethmoïde et sphénoïde (cadavre). J Med Insight. 2024; 2024(161.1). doi :10.24296/jomi/161.1.