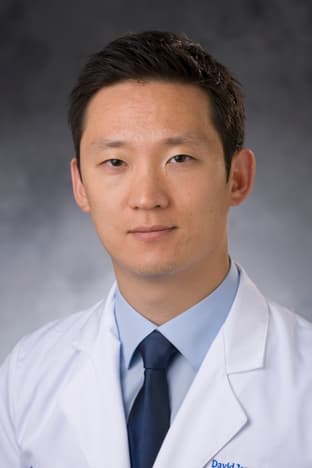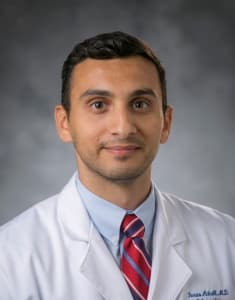Résection antérieure de la base du crâne de l’esthésioneuroblastome (endoscopique)
Main Text
Table of Contents
Décrit pour la première fois par Berger en 1924, l’esthésioneuroblastome (ENB) reste une tumeur sinonasale rare dont on pense qu’elle provient de cellules olfactives sensorielles spécialisées. À ce jour, la littérature comprend 1 000 cas enregistrés d’ENB. Les patients atteints d’ENB présentent souvent des symptômes non spécifiques, le plus souvent une obstruction nasale chronique ou une épistaxis. Un examen minutieux peut révéler une masse polyploïde rose ou brune dans la cavité nasale. Dans l’ensemble, l’ENB peut présenter divers modèles de croissance allant d’une progression lente et indolente à une invasion agressive avec métastases généralisées.
La littérature actuelle indique que l’ENB doit être traité par une combinaison de résection chirurgicale et de radiothérapie postopératoire avec ou sans chimiothérapie. Cependant, une controverse importante subsiste quant à l’approche chirurgicale appropriée. Cette vidéo fait la démonstration d’une approche endoscopique transnasale, qui a gagné en popularité au cours des deux dernières décennies par rapport aux approches « ouvertes » classiques. Bien que cette approche démontre de meilleurs résultats périopératoires tout en atteignant des marges oncologiques, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour évaluer la survie à long terme.
L’esthésioneuroblastome (ENB), également connu sous le nom de neuroblastome olfactif, est une tumeur neuroectodermique maligne rare de la cavité nasale. Ils proviennent de cellules olfactives sensorielles spécialisées situées dans la conque nasale supérieure, la face supérieure de la cloison nasale, le toit de la cavité nasale et la plaque cribriforme de l’os ethmoïdal. L’ENB a également été appelée tumeur du placode olfactif, œsessioneurocytome, esthésioneuroépithéliome et esthésioneurome.
Dans l’ensemble, on estime que les ENB représentent 2 % de toutes les tumeurs malignes du tractus sinonasal. Ces tumeurs sont extrêmement rares, avec une incidence estimée à 0,4 pour million de personnes. 1 La littérature évaluant les ENB est rare, avec seulement une estimation de 1 000 cas décrits depuis 1924. 2, 3
L’ENB peut survenir à n’importe quel âge, bien que les preuves indiquent une distribution bimodale centrée autour de la deuxième et de la sixième décennie de la vie. 1 Ces tumeurs surviennent aussi bien chez les hommes que chez les femmes, sans facteurs de risque liés au mode de vie, environnementaux ou géographiques actuellement connus.
Le patient typique atteint d’ENB présente des symptômes non spécifiques. Environ 70 % des patients signalent une obstruction nasale chronique, tandis que 50 % présentent une épistaxis. Les symptômes moins courants sont dus à l’invasion des structures locales et comprennent la douleur oculaire, l’aptose, la diplopie, le larmoiement excessif, la douleur à l’oreille, l’otite moyenne et les maux de tête. Bien que l’on pense que ces tumeurs proviennent de cellules olfactives, l’anosmie est une plainte rare, trouvée chez environ 5 % des patients. Des séries de cas ont déjà rapporté les syndromes paranéoplasiques suivants associés à l’ENB, qui peuvent être attribuables à la sécrétion ectopique d’hormones : syndrome de Cushing, hypercalcémie humorale maligne et syndrome de libération inappropriée d’hormone antidiurétique. 4 à 6
Comme pour tout patient présentant des inquiétudes concernant une tumeur maligne des voies sinuso-nasales, un examen physique approfondi est nécessaire. L’accent doit être mis sur les examens neurologiques, ophtalmologiques et de la tête et du cou. Un examen minutieux de la cavité nasale peut révéler une masse polyploïde friable rose ou brune chez les patients atteints d’ENB.
Tous les patients suspectés d’ENB doivent subir à la fois une tomodensitométrie (TDM) et une imagerie par résonance magnétique (IRM). 7 L’imagerie TDM des ENB révélera une masse homogène de tissus mous provenant de la voûte nasale. Il n’y a pas de caractéristiques spécifiques de TC des ENB. Cette modalité d’imagerie, cependant, est utile pour évaluer l’invasion des structures osseuses environnantes, y compris la plaque cribriforme, la fovéa ethmoïdale et la lamina papyracea. Il est également utile pour la planification chirurgicale.
Sur l’IRM, les ENB apparaîtront hypointenses sur les séquences pondérées en T1 alors qu’elles apparaîtront intermédiaires à hyperintenses sur les images pondérées en T2. Les kystes intracrâniens péritumoraux peuvent également être visualisés à la TDM, ce qui est très évocateur d’un diagnostic d’ENB. Bien que la TDM soit supérieure dans l’évaluation de l’atteinte osseuse, l’IRM est la meilleure modalité d’imagerie pour évaluer l’invasion des tissus mous, permettant de détecter une atteinte durale ou parenchymateuse. De plus, l’IRM peut être utilisée pour différencier les sécrétions nasales piégées et le néoplasme.
En raison de l’incidence importante de métastases ganglionnaires cervicales, l’imagerie du cou est également recommandée. Une étude a révélé que le principal site des métastases à distance est l’os. 8 Comme ces patients peuvent présenter une présentation asymptomatique, la scintigraphie osseuse a été suggérée comme composante de routine de l’évaluation ENB. 9
ENB présente un large éventail de modèles de croissance. La plupart sont considérés comme à croissance lente et indolents. S’ils sont identifiés comme étant confinés à la cavité nasale, les ENB ont un excellent pronostic. Cependant, un sous-ensemble de tumeurs est observé comme étant très agressif avec des métastases généralisées laissant présager de mauvais résultats. Le site le plus fréquent de métastases est le cou, qui a été observé chez 5 à 8 % des patients lors de la présentation initiale. 10 L’incidence des métastases distales a été estimée à 7 % lors de la présentation initiale, les sites les plus courants étant les os et les poumons. Des métastases ont également été détectées dans le foie, le médiastin, les glandes surrénales, les ovaires, la rate, les glandes parotides et l’espace épidural rachidien. 11
Il existe actuellement deux systèmes de stadification clinique pour les ENB. La mise en scène Kadish est la plus couramment utilisée. Il a été décrit pour la première fois en 1976 et a été modifié en 1993 par Morita pour inclure les métastases. 12-13 Le système de Kadish stratifie les patients en fonction de l’étendue de leur maladie, déterminée par l’imagerie :
Stade A – Confiné à la cavité nasale.
Stade B – Atteinte d’un ou plusieurs sinus paranasaux.
Stade C – Extension au-delà de la cavité nasale et des sinus paranasaux.
Stade D – Ganglion lymphatique régional ou métastases à distance.
En 1992, Dulguerov a développé un système de stratification des patients basé sur la classification tumeur-ganglion-métastase. 14 Ce système est plus précis dans ses classifications avec la reconnaissance de l’atteinte précoce de la plaque cribriforme ainsi que la différenciation entre l’invasion intracrânienne et extradurale et une véritable atteinte cérébrale. Une étude comparant les deux systèmes a révélé qu’une stadification plus avancée avec l’un ou l’autre était inversement corrélée avec la survie sans maladie et la survie globale, mais que le système Dulguerov était meilleur pour discriminer les résultats. Cela était particulièrement vrai chez les patients classés au stade C de Kadish, qui a été critiqué pour être un groupe hétérogène. 15
Il n’y a pas de consensus concernant un algorithme qui pourrait être utilisé pour déterminer la modalité de traitement optimale pour les patients atteints d’ENB. Dans l’ensemble, la littérature s’accorde à dire que l’excision chirurgicale avec radiothérapie postopératoire avec ou sans chimiothérapie est la meilleure approche. Cependant, il existe une controverse quant à l’approche appropriée. La résection craniofaciale ouverte a été classiquement utilisée, mais l’approche endoscopique transnasale est devenue plus courante ces dernières années. En général, les patients qui se présentent aux premiers stades de la maladie peuvent être traités de manière adéquate uniquement par des approches endoscopiques transnasales, tandis que les patients atteints d’une maladie avancée peuvent nécessiter une chirurgie ouverte. Les pratiques actuelles sont souvent déterminées par l’expérience du chirurgien et du centre.
Chez notre patient, l’approche endoscopique transnasale a été recommandée en fonction de la taille et du stade clinique de la tumeur. Dans l’ensemble, cette approche a une morbidité plus faible, la littérature actuelle suggérant des résultats comparables à ceux de la résection craniofaciale ouverte dans le traitement des ENB à un stade précoce. 16
Pour les patients stadifiés à Kadish A, l’approche endoscopique transnasale peut être considérée comme la seule modalité de traitement. Pour les patients des Cadish B et C, une association d’exérèse chirurgicale et de radiothérapie doit être envisagée. Les patients présentant des métastases à distance sont considérés comme de mauvais candidats à la chirurgie.
L’ENB reste une tumeur maligne rare des voies sinuso-nasales. Depuis qu’il a été décrit pour la première fois par Berger en 1924, il n’y a eu qu’environ 1 000 cas publiés dans la littérature. Dans l’ensemble, ces tumeurs présentent un large éventail de modèles de croissance allant de lentes et indolentes à très agressives avec des métastases à distance. En général, la littérature s’accorde à dire que l’ENB devrait être traité par excision chirurgicale avec radiothérapie postopératoire avec ou sans chimiothérapie chez les patients considérés comme de bons candidats chirurgicaux. Cependant, la controverse demeure quant à l’approche appropriée. Au cours des deux dernières décennies, l’approche endoscopique transnasale a gagné en popularité, la littérature récente faisant état de résultats à court et à long terme similaires ou améliorés par rapport à la résection craniofaciale ouverte.
À l’heure actuelle, la résection craniofaciale est l’étalon-or de traitement de l’endo-épilos. Cette opération, cependant, présente un risque élevé de complications périopératoires dues à des fuites de liquide céphalo-rachidien, à une méningite, à des convulsions et à une hémorragie intracrânienne. L’incidence de ces événements a été estimée entre 30 et 60 %. 16 Avec les progrès continus de la technologie, l’utilisation des approches endoscopiques transnasales a gagné en popularité. En plus d’éviter les cicatrices faciales importantes, il a été démontré que cette technique réduit l’incidence des complications. 17 Bien qu’il y ait eu des craintes initiales que la chirurgie endoscopique ne permette pas une visualisation adéquate, il a été démontré que cette approche peut permettre d’obtenir des marges oncologiques si elle est pratiquée par des chirurgiens expérimentés. 18
Une méta-analyse initiale réalisée en 2009 a suggéré que la chirurgie endoscopique avait des résultats à long terme comparables à la chirurgie ouverte traditionnelle. Dans leur étude portant sur 361 patients traités pour l’ENB, Devaiah et ses collègues ont noté une amélioration significative des taux de survie chez les patients qui n’ont subi qu’une chirurgie endoscopique transnasale. 19 En fait, cette étude a rapporté un taux de survie de 100 % pour ce sous-groupe ; Cependant, ils ont noté que cette constatation était trompeuse. Par rapport aux patients traités par une approche endoscopique transnasale, ceux qui ont subi une chirurgie ouverte étaient plus susceptibles d’avoir une maladie avancée classée comme tumeurs de Kadish C et D. De plus, il y avait plus de cas de suivi à long terme dans le groupe de chirurgie ouverte. La durée moyenne de récidive de l’ENB a été estimée entre 2 et 6 ans, les cas étant rapportés jusqu’à 19 ans après la résection initiale. 11 Bien qu’elle ait présenté des résultats prometteurs, cette méta-analyse initiale pourrait ne pas saisir complètement les résultats après une chirurgie endoscopique transnasale pour l’ENB.
En réponse aux limites de l’étude Devaiah, Fu et al. ont effectué une méta-analyse qui a contrôlé le stade de la tumeur et le grade histologique. 16 Évaluant 609 patients traités pour ENB entre 2000 et 2014, cette étude a comparé les résultats entre la chirurgie endoscopique et la chirurgie ouverte dans l’ensemble de la cohorte, chez les patients classés comme Kadish C ou D uniquement, et chez les patients classés comme Hyman III et IV uniquement. Sur l’analyse univariée de l’ensemble de la cohorte, les patients traités à l’aide d’une approche endoscopique transnasale avaient une survie globale améliorée et une survie spécifique à la maladie. Cependant, il n’y avait pas de différences entre les groupes lors de l’évaluation du contrôle locorégional et de la survie sans métastases. Des résultats similaires ont été observés dans l’analyse de sous-populations de tumeurs de stade avancé et de haut grade. Ces résultats suggèrent que les patients traités par endoscopie ont des taux de récidive similaires, mais présentent une incidence de mortalité réduite par rapport à leurs homologues subissant des procédures ouvertes. À l’instar de la méta-analyse de Devaiah, Fu a postulé que cela pourrait être dû à un plus grand nombre de cas de suivi à long terme dans le groupe de chirurgie ouverte. De plus, les patients qui ont initialement subi une chirurgie endoscopique transnasale et qui développent une récidive peuvent bénéficier de meilleures techniques de sauvetage, car la majorité de ces cas ont été réalisés plus récemment.
En conclusion, le traitement de l’ENB par chirurgie endoscopique transnasale est devenu plus largement accepté au cours des deux dernières décennies. Bien que les résultats à court terme de cette approche semblent être plus favorables que ceux de la résection craniofaciale ouverte, la survie à long terme reste controversée. Comme il a été noté que des cas de récidive se produisent des décennies après le traitement initial, des travaux futurs sont nécessaires pour évaluer les résultats à long terme de cette procédure.
L’auteur C. Scott Brown travaille également comme rédacteur en chef de la section Oto-rhino-laryngologie du Journal of Medical Insight.
Le patient visé dans cet article vidéo a donné son consentement éclairé pour être filmé et est conscient que des informations et des images seront publiées en ligne.
References
- Thompson LDR. Neuroblastome olfactif. Tête Cou Pathol. 2009; 3(3):252-259. doi :10.1007/s12105-009-0125-2.
- Berger L, Luc R, Richard D. L’esthesioneuroepitheliome olfactif. Bull Assoc Fr Etude Cancer. 1924;13:410-421.
- Ward, Heth JA, Thompson BG et Marentette LJ. Esthesloneuroblastome : résultats et résultats de l’expérience d’un seul établissement. Base du crâne. 2009; 19(2):133-140. doi :10.1055/s-0028-1096195.
- Koo BK, An JH, Jeon KH, et al. Deux cas de syndrome ectopique de l’hormone adrénocorticotrope avec neuroblastome olfactif et revue de la littérature. Endocr J. 2008; 55(3):469-475. doi :10.1507/endocrj. N° K07E-005.
- Sharma S, Lasheen W, Walsh D. Hypercalcémie réfractaire paranéoplasique due à une esthésion métastatique avancéeuroblastome. Rhinologie. 2008; 46(2):153-5.
- Wong E, Choroomi S, Palme CE, Singh NP. Esthésion primaire isolée du sinus maxillaireeuroblastome se présentant sous la forme d’un syndrome idiopathique d’hormone antidiurétique inappropriée. Représentant de cas BMJ 2019; 12(5). doi :10.1136/bcr-2018-228666.
- Dublin AB, Bobinski M. Caractéristiques d’imagerie du neuroblastome olfactif (esthésioneuroblastome). J Neurol Surg B Base du crâne. 2015; 77(1):1-5. doi :10.1055/s-0035-1564053.
- Koka VN, Julieron M, Bourhis J, et al. Aesthesioneuroblastome. J Laryngol Otol. 1998; 112(7):628-633. doi :10.1017/s0022215100141295.
- Bradley PJ, Jones NS, Robertson I. Diagnostic et prise en charge de l’esthésioneuroblastome. Curr Opin Otolaryngol Tête Chirurgie du cou 2003; 11(2):112-118. doi :10.1097/00020840-200304000-00009.
- Banuchi VE, Dooley L, Lee NY, et al. Schémas de métastases régionales et à distance dans l’esthésioneuroblastome. Laryngoscope. 2016; 126(7):1556-1561. doi :10.1002/lary.25862.
- Fiani B, Quadri SA, Cathel A, et al. Esthesioneuroblastome : un examen complet du diagnostic, de la prise en charge et des options de traitement actuelles. Neurochirurgie mondiale. 2019;126:194-211. doi :10.1016/j.wneu.2019.03.014.
- Kadish S, Goodman M, Wang CC. Neuroblastome olfactif - une analyse clinique de 17 cas. Le cancer. 1976; 37(3):1571-1576. doi :10.1002/1097-0142(197603)37:3<1571 ::aid-cncr2820370347>3.0.co ; 2 l.
- Morita A, Ebersold MJ, Olsen KD, Foote RL, Lewis JE, Quast LM. Esthésioneuroblastome : pronostic et prise en charge. Neurochirurgie. 1993; 32(5):706-715. doi :10.1227/00006123-199305000-00002.
- Dulguerov P, Calcaterra T. Esthesioneuroblastome : l’expérience de l’UCLA 1970-1990. Laryngoscope. 1992; 102(8):843-849. doi :10.1288/00005537-199208000-00001.
- Arnold MA, Farnoosh S, Gore MR. Comparaison des systèmes de stadification de Kadish et de Dulguerov modifiés pour le neuroblastome olfactif : une méta-analyse des données des participants individuels. Otolaryngol - Head Neck Surg (États-Unis). 2020; 163(3):418-427. doi :10.1177/0194599820915487.
- Fu TS, Monteiro E, Muhanna N, Goldstein DP, De Almeida JR. Comparaison des résultats des approches ouvertes par rapport aux approches endoscopiques pour le neuroblastome olfactif : une revue systématique et une méta-analyse des données individuelles des participants. Tête et cou. 2016; 38 :E2306 à E2316. doi :10.1002/hed.24233.
- Song CM, Won T-B, Lee CH, Kim D-Y, Rhee C-S. Modalités de traitement et résultats du neuroblastome olfactif. Laryngoscope. 2012; 122(11):2389-2395. doi :10.1002/lary.23641.
- Folbe A, Herzallah I, Duvvuri U, et al. Résection endonasale endoscopique de l’esthésioneuroblastome : une étude multicentrique. Am J Rhinol Allergie. 2009; 23(1):91-94. doi :10.2500/ajra.2009.23.3269.
- Traitement de l’esthésioneuroblastome : une méta-analyse de 16 ans portant sur 361 patients. Laryngoscope. 2009; 119(7):1412-1416. doi :10.1002/lary.20280.
Cite this article
Jang DW, Zomorodi AR, Ackall F, Madrigal J, Brown CS. Résection de la base antérieure du crâne de l’esthésioneuroblastome (endoscopique). J Med Insight. 2023; 2023(132). doi :10.24296/jomi/132.