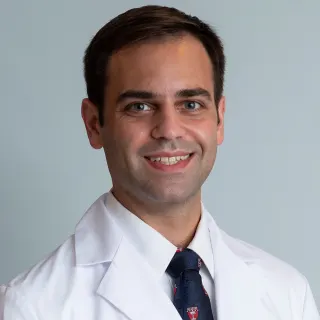Tibia gauche, Pilon Fracture ouverte, Réduction ouverte et fixation interne avec fixateur externe
Main Text
Table of Contents
Les fractures du plafond tibial ou du pilon représentent 5 à 10 % de toutes les fractures des membres inférieurs et sont associées à des traumatismes à haute énergie. Ils sont le résultat d’une charge principalement axiale résultant en un motif typique à trois fragments et comminutif. 1 Ces fractures ont un taux élevé de problèmes de non-consolidation, de mal-union et de cicatrisation des plaies en raison de la faiblesse de l’os métaphysaire, d’un manque de couverture robuste des tissus mous et d’une extension intra-articulaire complexe.
Les premières études montrant des taux plus élevés de complications après une prise en charge aiguë ont promu une stratégie de prise en charge « par étapes ». 2,3 Dans cette approche, la blessure initiale est initialement stabilisée à l’aide d’une fixation externe temporaire et la fixation définitive est retardée jusqu’à ce que les tissus mous se prêtent à la fermeture primaire des incisions. Bien que la prise en charge par étapes ait été considérée comme la norme de pratique, des travaux plus récents ont rapporté de bons résultats avec une fixation définitive aiguë chez des patients bien sélectionnés. 4,5
Dans ce manuscrit et cette vidéo, nous démontrons une fracture du pilon tibial gérée de manière aiguë avec une approche de fixation hybride combinant la fixation interne et la fixation externe.
Une anamnèse ciblée doit inclure l’âge du patient, ses antécédents médicaux et son état fonctionnel, et doit élucider le mécanisme de la blessure. La principale préoccupation dans la prise en charge aiguë des fractures du pilon tibial, en particulier lorsqu’il s’agit d’une fixation interne aiguë, est l’intégrité de l’enveloppe des tissus mous. L’examinateur doit découvrir toute condition médicale, médicament ou habitude sociale susceptible de compromettre la peau ou de retarder la guérison. Des exemples importants incluent le diabète, les maladies vasculaires périphériques, l’utilisation de médicaments immunosuppresseurs, l’utilisation à long terme de corticostéroïdes et le tabagisme actif ou d’autres utilisations de nicotine. Les blessures à haute énergie chez un jeune patient suggèrent une zone plus grande de lésions des tissus mous et seront plus susceptibles d’entraîner un gonflement important dans les jours suivant la blessure. Les mécanismes de faible énergie, tels que ceux souvent observés chez les patients gériatriques, peuvent ne pas causer autant de dommages supplémentaires aux tissus environnants.
Dans ce cas, il s’agit d’une femme de 44 ans qui a fait une chute en descendant les escaliers la veille de sa présentation à notre service d’urgence. Ses antécédents médicaux sont importants pour l’anxiété, la dépression et le tabagisme actif. Son indice de masse corporelle (IMC) est de 25. Elle s’est d’abord présentée dans un autre établissement où on lui a diagnostiqué une fracture ouverte du tibia et du péroné gauche de type 1 de Gustillo-Anderson et où elle a reçu de la céfazoline par voie intraveineuse. Sa jambe a été attelée pour une immobilisation préliminaire avant d’être transférée à notre intuition. Au moment de l’admission dans notre établissement, 24 heures s’étaient écoulées depuis la blessure. Les marqueurs de laboratoire obtenus n’étaient pas remarquables, l’hématocrite et le nombre de globules blancs étaient dans les limites normales.
Dans le cas de blessures aux membres inférieurs à haute énergie, l’ensemble de l’extrémité doit être évalué. Tout d’abord, évaluez les plaies ouvertes qui peuvent être directement associées ou en continuité avec le site de la fracture dans la zone de la blessure. La gestion des blessures ouvertes par le service d’urgence doit inclure une irrigation précoce pour éliminer tout corps étranger évident ou toute contamination grossière de la plaie. Dans notre établissement, nous effectuons un lavage salin au service des urgences de toutes les plaies ouvertes associées à des fractures, puis nous couvrons la plaie avec une gaze imbibée d’une solution iodée. Après l’évaluation des plaies ouvertes, l’état général du reste des tissus mous doit être pris en compte. La quantité de gonflement doit être notée ; L’absence de rides cutanées suggère un œdème important qui peut compromettre la guérison. Toute vésicule de fracture doit être reconnue et recouverte d’un pansement imprégné de pétrole. Les fragments de fracture déplacés peuvent provoquer des tensions cutanées qui peuvent entraver la perfusion et entraîner une dégradation de la peau. La menace pour la peau est indiquée par une peau blanchie recouvrant un fragment osseux et doit être reconnue. Après l’évaluation des plaies et autres défauts cutanés sus-jacents, un examen neuromoteur et vasculaire complet doit être effectué.
La documentation du niveau de sensation et de la fonction des groupes musculaires ainsi que de la présence ou de l’absence de pouls et d’un bon remplissage capillaire doit être effectuée. Lorsqu’il existe des préoccupations concernant une lésion vasculaire, l’angiographie par tomodensitométrie (TDM) obtenue permet de mieux définir la lésion vasculaire après stabilisation de la fracture.
L’examen physique global de notre patient de l’extrémité inférieure gauche était significatif pour une déformation évidente avec une petite blessure (< 1 cm) sur le côté médial de la cheville. Les tissus mous étaient par ailleurs bien entretenus. Il y avait un gonflement minime de la jambe, sans cloques de fracture. Aucune autre zone de peau menaçante n’a été notée. La jambe était molle et tous les compartiments étaient compressibles. Le patient était sensible à la palpation sur la cheville, mais avait une amplitude de mouvement passive indolore du genou et des orteils. Elle a été capable d’activer les muscles tibiaux antérieurs, extenseurs de l’hallucis long et fléchisseurs de l’hallucis longus. La sensation était intacte dans les distributions des nerfs saphènes, suraux et péroniers superficiels et profonds. Des pouls palpables positifs étaient évidents sur les artères du pédia dorsal et du tibial postérieur. Les orteils étaient bien perfusés.
Les radiographies doivent être obtenues dès la présentation. Les radiographies initiales doivent consister en des vues de l’ensemble du tibia et du péroné pour déterminer l’étendue proximale de la blessure, ainsi qu’une série de chevilles qui comprend une vue à mortaise (rotation interne de 15 degrés) pour évaluer l’alignement et la fragmentation au niveau du plafond tibial. La tomodensitométrie est un élément crucial et de routine de l’évaluation préopératoire de la plupart des fractures du plafond tibial. Il a été démontré que la tomodensitométrie améliore la compréhension du nombre et de l’emplacement des fragments de fracture, de l’étendue de l’atteinte articulaire et de l’emplacement de la ligne de fracture principale. 6 L’évaluation par tomodensitométrie entraîne souvent des modifications du plan chirurgical par rapport à l’utilisation des radiographies seules. 6 Les images de tomodensitométrie axiale sont particulièrement utiles pour identifier les principaux fragments de fracture et planifier le placement des incisions chirurgicales. 1
L’imagerie obtenue dans ce cas comprenait des radiographies tib-fib montrant un tibia distal et une fracture du péroné. La fracture fibulaire était une simple fracture transversale au-dessus du niveau de la syndesmose. Dans la vue latérale, un raccourcissement et une angulation postérieure de la fracture ont été remarqués. La fracture distale du tibia était une fracture oblique au même niveau que la fracture du péroné. L’extension intra-articulaire était difficile à évaluer dans les vues antéro-postérieure (AP) et latérale.
Une tomodensitométrie du membre inférieur a montré le « motif en forme de Y » typique des coupes axiales au niveau du plafond tibial. Un fragment de Volkmann (postérolatéral) très comminutif, un fragment de Chaput (antérolatéral) également comminutif et un fragment malléolaire médial ont été observés dans les coupes axiales.
Dans la vue coronale, on a remarqué que le tibia tombait en valgus au niveau de la longue ligne de fracture oblique dans la métaphyse, également dans la vue coronale, il y avait un petit fragment impacté et retourné au milieu du plafond.
Les fractures du plafond tibial sont traitées chirurgicalement dans presque tous les cas en raison des taux élevés de malunion avec le traitement non chirurgical. 7 La prise en charge initiale peut consister en la mise en place d’un fixateur externe uniplanaire provisoire couvrant l’étendue de la cheville s’il y a des inquiétudes quant à l’état des tissus mous, tels qu’un œdème important et/ou la formation d’ampoules de fracture. En cas d’utilisation, la fixation externe reste généralement en place pendant 7 à 21 jours jusqu’à ce que l’enflure ait disparu et que la peau se prête à la fermeture des incisions. À l’inverse, une fixation interne définitive aiguë peut être tentée si l’enflure est minime. Une fixation externe définitive, souvent avec un cadre en fil mince, peut être utilisée chez certains patients présentant un risque extrêmement élevé de complications de cicatrisation. Au cours des dernières années, certains chirurgiens ont préconisé l’utilisation de la fusion tibiotalocalancelle primaire (TTC) par clouage intramédullaire rétrograde de l’arrière-pied comme traitement définitif des fractures du pilon chez certains patients âgés peu exigeants, les patients atteints de diabète mal contrôlé et/ou les cas de comminution articulaire extrême. Cependant, le clouage de l’arrière-pied permet d’obtenir une stabilité de la cheville au détriment de la perte de mouvement de la cheville et de l’articulation sous-talienne et reste donc réservé à des cas limités. 8 Dans la grande majorité des cas, la prise en charge chirurgicale définitive consiste en une fixation interne par réduction ouverte (ORIF) avec des constructions à plaques et à vis.
L’ORIF peut être réalisée à l’aide de plusieurs approches chirurgicales. Chaque approche utilise un intervalle intramusculaire différent pour exposer principalement un aspect spécifique du tibia et/ou du péroné. Souvent, plusieurs approches sont combinées. Les incisions et les approches prévues doivent être adaptées au modèle de fracture unique du patient tout en tenant compte des plaies autour de la cheville. 1 Les approches les plus couramment utilisées sont antérolatérales, antéromédiales et postérolatérales. Dans l’approche antérolatérale, l’intervalle entre les tendons du compartiment antérieur et le péroné est utilisé. Une incision est pratiquée dans l’axe de l’espace entre les 3e et 4e métatarsiens, commençant distale à l’articulation de la cheville et s’étendant à environ 5 cm à proximité de l’articulation. 9.10 Il faut veiller à éviter de blesser le nerf péronier superficiel. Les tendons du compartiment antérieur sont soulevés et rétractés médialement pour exposer le tibia distal latéral et le plafond antérieur. L’approche antéromédiale exploite l’espace entre le tendon tibial antérieur (TA) et la malléole médiale pour exposer la colonne médiale du tibia. L’incision commence médialement juste distale par rapport à la malléole médiale et s’incurve antérieurement plus proximale le long de l’AT. Un lambeau cutané peut être soulevé pour exposer la malléole médiale et le tibia médial et les tendons du TA et du compartiment antérieur adjacent peuvent être rétractés latéralement pour exposer la ligne articulaire antérieure. Dans le cas d’une fracture du péroné associée, l’approche antéromédiale peut être associée à une approche latérale directe pour la fixation du péroné. 10 La colonne postérieure du tibia est le plus souvent accessible par un intervalle postérolatéral entre les tendons fléchisseurs de l’hallucis long (FHL) et longus péronier (PL). Cette approche est généralement réalisée avec le patient couché. L’incision postérolatérale est pratiquée à mi-chemin entre le tendon d’Achille et la malléole latérale. Le fascia profond est exposé, en prenant soin d’éviter de blesser le nerf sural. Le fascia est ouvert et les tendons péroniers rétractés latéralement. Le tibia postérieur est exposé en élevant les fibres musculaires distales du FHL. Une fracture du péroné associée peut également être accessible et fixée par l’incision postérolatérale. De nombreuses autres approches ont été décrites et sont souvent utilisées, y compris les approches antérieures et postéromédiales directes.
Dans de nombreux cas, plusieurs approches chirurgicales peuvent être nécessaires pour réduire adéquatement les fractures et appliquer une fixation. La fixation d’une fracture du péroné associée est une raison fréquente d’utilisation d’une deuxième incision. Le péroné est accessible par une approche latérale directe qui exploite l’intervalle internerveux entre le long extenseur des doigts (nerf péronier profond) et le péronier court (nerf péronier superficiel). L’utilisation d’une deuxième incision augmente les inquiétudes concernant les complications de cicatrisation des plaies et la nécrose des ponts cutanés. En règle générale, on pense que les incisions doivent être séparées d’au moins 7 cm. Cependant, une manipulation soigneuse des tissus mous et la fermeture des incisions à l’aide de techniques de suture préservant la perfusion peuvent permettre de réduire la taille des ponts cutanés. Une étude prospective portant sur 46 fractures du pilon a révélé un faible risque de complications de cicatrisation avec des ponts cutanés de 5,9 cm en moyenne et de 83 % de <7 cm lorsque la dissection excessive des tissus mous et la rétraction trop vigoureuse étaient évitées et que les plaies étaient suturées à l’aide de la technique Allgower-Donati. 11 Pour réduire le risque de complications de cicatrisation des plaies avec plusieurs incisions, l’emplacement de toutes les incisions nécessaires doit être soigneusement planifié avant l’opération.
Une fois que le tibia fracturé est exposé, des fragments corticaux peuvent être réservés ouverts pour exposer les fragments articulaires inclus. Les fragments individuels sont manipulés et réduits en utilisant le dôme talaire intact comme modèle. La réduction provisoire peut être maintenue à l’aide d’une combinaison de fils Kirchner (fils k) et de pinces de réduction pointues. La fixation définitive est réalisée en appliquant des plaques de verrouillage à petits fragments anatomiquement profilées dans des positions qui résistent au valgus ou à l’effondrement du valgus, en fonction du modèle de fracture. Des vis indépendantes de 3,5 millimètres (mm) ou de 2,7 mm peuvent être utilisées entre les fragments pour reconstruire la surface articulaire. 11,121314–17
Les objectifs du traitement des fractures du plafond tibial sont la réduction anatomique des fragments articulaires pour recréer une surface articulaire congruente, la préservation du cartilage articulaire et la restauration des relations anatomiques et l’alignement mécanique de l’articulation de la jambe et de la cheville.
Compte tenu de la présence d’une fracture ouverte, une intervention chirurgicale a été indiquée pour ce patient de manière urgente. La procédure a commencé par l’exploration de la plaie, l’irrigation et le débridement pour traiter la fracture ouverte. Une incision antéromédiale a ensuite été choisie comme approche principale en tenant compte de deux facteurs : 1) la tomodensitométrie a suggéré que le modèle de fracture pourrait être réparé par cette approche tout en permettant l’accès au coin antéro-médial de l’articulation de la cheville pour visualiser l’articulation pour une réduction anatomique appropriée, et 2) la plaie ouverte pourrait être incorporée dans l’incision prévue. Comme l’enflure de la peau était minime et qu’une incision était déjà nécessaire pour l’irrigation et le débridement de la fracture ouverte, nous avons procédé à une ORIF aiguë. Un fixateur externe a été utilisé pour la stabilisation provisoire en peropératoire et a été laissé en place à la fin du boîtier.
L’utilisation d’une approche antéromédiale a été utile pour traiter la défaillance axiale du tibia avec compression latérale, ainsi, l’approche antéromédiale nous permettrait de traiter cette déformation coronale. Grâce à cette approche, nous avons pu réduire à la fois le fragment de Chaput et celui de Volkmann avec des fils k et finalement une fixation avec la plaque. L’utilisation d’une deuxième incision pour traiter la fracture du péroné a permis d’obtenir de la longueur et de rétablir l’alignement du tibia et du péroné.
La blessure de notre patient a entraîné une fracture hautement comminutive qui a nécessité à la fois une réduction ouverte et une fixation interne, ainsi que l’application supplémentaire d’un fixateur externe pour plus de stabilité et pour protéger la fixation sous-jacente et les tissus mous. La décision d’appliquer un fixateur externe a été prise en peropératoire et a permis de maintenir la longueur et l’alignement globaux du tibia et du péroné. La TDM préopératoire a été utile pour comprendre le schéma de fracture et planifier une approche chirurgicale appropriée. 10
La présence d’une plaie ouverte au moment de l’évaluation initiale devrait inciter à l’instauration immédiate d’une antibiothérapie intraveineuse. Le choix de l’antibiotique est déterminé par l’atteinte des tissus mous de la blessure, telle que déterminée par la classification de Gustilo-Anderson. 12 De nombreux protocoles antibiotiques ont été proposés. Le plus souvent, les fractures de type I et de type II sont traitées avec une céphalosporine de 1ère génération (par exemple la céfazoline), tandis que les fractures de type III reçoivent en outre un aminoglycoside (par exemple la gentamicine), tandis que la pénicilline est ajoutée pour la contamination extensive du sol. Un protocole plus récemment proposé utilise la céfazoline pour les fractures de type I et II et la ceftriaxone pour le type III. 13 Afin de réduire le fardeau décisionnel des fournisseurs de première ligne au service des urgences, notre établissement utilise un protocole simplifié selon lequel la céfazoline est administrée pour les fractures de type I et la pipéracilline-tazobactam pour toute fracture de type II ou plus.
L’utilisation d’un garrot de la cuisse en peropératoire peut améliorer la visualisation des fragments de fracture et réduire la perte de sang peropératoire. Un garrot peut être particulièrement utile dans le traitement des fractures du pilon, car l’hématome peut masquer les lectures de réduction pour les petits fragments articulaires. L’utilisation d’un garrot se fait au prix d’une augmentation de la douleur peropératoire et postopératoire et comporte de faibles risques de lésions nerveuses et musculaires. Des pratiques sécuritaires en matière de garrot doivent être suivies, notamment laisser le garrot gonflé pendant au plus 2,5 heures consécutives et le relâcher pendant 10 minutes de reperfusion au bout de 2,5 heures et toutes les heures par la suite.14
Les fractures du plafond tibial, souvent appelées fractures du pilon, sont des lésions complexes de la jambe distale avec une perturbation importante des os et des tissus mous. Historiquement, le traitement non chirurgical des fractures du plafond tibial était associé à une faible réduction de la surface articulaire, à un mauvais maintien de l’alignement mécanique de la cheville et à une faible fonction résultante. Par conséquent, dans la pratique actuelle, ces fractures sont presque toujours considérées comme des blessures opératoires.
Les chirurgiens sont confrontés à une multitude de choix lorsqu’ils planifient le traitement opératoire des fractures du plafond tibial. Lors de la présentation initiale de la blessure, les chirurgiens doivent choisir une fixation définitive aiguë par rapport à une approche progressive avec fixation externe temporaire. Les données concernant la prise en charge aiguë ou par étapes des fractures du pilon sont contradictoires. La principale considération est le risque de complications de la plaie après une fixation chirurgicale aiguë. Les fractures du pilon tibial sont généralement des blessures à haute énergie qui développent rapidement un gonflement aigu des tissus mous, y compris des cloques. Cela est dû en grande partie à la minceur de la peau de la cheville avec peu de tissu sous-cutané protecteur. Le tibia et le péroné sont tous deux sous-cutanés au niveau de la cheville. Dans ces cas, l’application d’un fixateur externe couvrant la cheville a été une méthode de temporisation utile pour protéger l’enveloppe des tissus mous traumatisés et pour permettre une fixation définitive étagée, en toute sécurité, lorsque les tissus mous sont améliorés et peuvent mieux tolérer la chirurgie (7 jours ou plus plus tard). Dans certains cas, la fixation externe peut fonctionner comme un traitement définitif. D’autres études ont démontré que la réduction ouverte aiguë et la fixation interne (ORIF), lorsqu’elles sont effectuées de manière appropriée, dans le respect de l’intégrité des tissus mous, avec une taille et un emplacement d’incision appropriés, peuvent entraîner des résultats similaires avec moins de temps opératoire et de coût global de traitement. 18 à 21 Certaines études ont démontré l’efficacité et l’innocuité de la fixation précoce, avec des critères clairs tels que l’absence de gonflement excessif des tissus mous et l’absence de cloques de fracture. Il existe un certain nombre de variables connues qui augmenteront le risque d’infection et de complications des plaies, quel que soit le moment de la fixation (sexe masculin, tabagisme et diabète). La plupart des études récentes s’accordent à dire que les patients ayant une bonne enveloppe de tissus mous, la présence de rides cutanées, une faible énergie et sans comorbidités significatives, une fixation aiguë peut être raisonnable et sûre. 19,20
La présence d’une fracture ouverte nécessite une incision chirurgicale pour une irrigation et un débridement approfondis. Dans un tel cas, les chirurgiens peuvent être plus susceptibles d’opter pour une fixation interne au moins partielle de manière aiguë. Une fois qu’il décide d’aller de l’avant avec une fixation interne définitive, le chirurgien doit sélectionner la ou les approches chirurgicales qui permettront d’accéder en toute sécurité aux fragments de fracture cruciaux afin de pouvoir à la fois reconstruire le plafond tibial et restaurer et maintenir la longueur et l’alignement mécanique du tibia. De multiples approches chirurgicales ont été décrites en utilisant des intervalles intramusculaires antérieurs, postérieurs et latéraux, chacun d’entre eux donnant accès à une région spécifique du tibia.
Dans le cas décrit dans cette vidéo, une incision a été nécessaire pour l’irrigation et le débridement d’une fracture ouverte. La blessure traumatique se trouvait sur le chemin d’une incision pour une approche antéromédiale, qui a été utilisée. Étant donné que cette incision était pratiquée et que l’enflure de la peau restait minime plus de 24 heures après la blessure, l’enveloppe des tissus mous a été jugée appropriée et sûre pour la fixation chirurgicale aiguë et nous avons choisi de procéder à une ORIF définitive aiguë. Nous avons réalisé une approche hybride avec à la fois une fixation aiguë complétée par une fixation externe. Tout d’abord, une broche transcalcanéenne a été placée pour pouvoir tirer la traction et aider à la réduction du péroné et du tibia pour le placage, permettant ainsi la restauration de la longueur anatomique. Une plaque semi-tubulaire de 3,5 mm à six trous 1/3 non verrouillable a été appliquée sur le péroné après réduction obtenue. Des fils K ont été utilisés pour la stabilité temporaire.
Après la fixation du péroné, un fixateur externe couvrant la cheville a été construit en ajoutant des broches Shantz au tibia et en connectant les pinces et les barres appropriées. L’alignement anatomique du tibia qui a restauré la longueur de la colonne médiale a ensuite été réalisé à l’aide de la manipulation du fixateur externe sous imagerie fluoroscopique et le cadre a été resserré. Ensuite, une plaque non verrouillable de 3,5 mm pour le tibia distal médial anatomiquement profilé a été appliquée couvrant la zone de broyage. Une fixation supplémentaire a été réalisée à l’aide de vis de 3,5 mm perpendiculaires au plan de fracture antérieur et postérieur. Parallèlement à l’application de la plaque, le vide osseux sous-jacent a été rempli d’une greffe osseuse composée de puces d’allogreffe spongieuses. Les plaies ont ensuite été abondamment irriguées avec des solutions salines et fermées principalement par l’application de 1 gramme de poudre de vancomycine lors de la fermeture de la plaie. Bien que le fixateur externe soit souvent retiré à la suite d’une ORIF de fractures du pilon tibial, dans ce cas, nous avons choisi de le maintenir en postopératoire. Cela a été fait pour plusieurs raisons. Tout d’abord, compte tenu de la fragmentation du cortex tibial, l’ex-fix a fourni une stabilité accrue pendant les premiers stades de guérison pour se prémunir contre l’échec du valgus. Deuxièmement, le patient présentait un risque accru de complications de cicatrisation compte tenu de la fracture ouverte et du tabagisme actif ; Le maintien du fixateur externe a permis d’assurer la stabilité des tissus mous tout en laissant les incisions accessibles pour la surveillance, ce qui n’aurait pas été possible dans une attelle postopératoire à jambe courte.
Le patient a reçu son congé de la maison le 4e jour postopératoire après s’être déplacé en toute sécurité et de manière autonome à l’aide d’un appareil fonctionnel et avoir réussi à bien gérer la douleur. Le patient a été rendu non porteur (NWB) sur le membre opéré et le dispositif de fixation externe a empêché toute amplitude de mouvement au niveau de la cheville. Le premier suivi a eu lieu 15 jours après l’opération, et à ce moment-là, le patient a démontré une incision bien cicatrisée, et tout le matériel était intact lors de l’évaluation radiographique. On lui a demandé de rester NWB sur l’extrémité inférieure gauche. À la 4e semaine postopératoire, le patient a été ramené en salle d’opération pour le retrait et l’examen du fixateur externe. L’examen a révélé une construction de fixation stable sans signes de défaillance matérielle ou d’autres problèmes radiographiques.
- Grand fixateur externe.
- Fils Kirschner de différentes tailles.
- Pinces de réduction Weber de différentes tailles.
- Plaques tibiales distales profilées anatomiquement.
- Plaques de verrouillage et de non-verrouillage à petits fragments.
- Vis de verrouillage et non verrouillables à petits fragments.
References
- Cole PA, Mehrle RK, Bhandari M, Zlowodzki M. La carte des pilons : lignes de fracture et zones de broyage dans les fractures de pilon de type OTA/AO 43C3. J Orthop Trauma. 2013 ; 27(7) :e152 et e156. doi :10.1097/BOT.0B013E318288A7E9.
-
Sirkin M, Sanders R, DiPasquale T, Herscovici D Jr. Un protocole par étapes pour la gestion des tissus mous dans le traitement des fractures complexes du pilier. J Traumatisme orthop. 1999 février ; 13(2):78-84. doi :10.1097/00005131-199902000-00002.
- Patterson, MJ. Réduction ouverte retardée en deux étapes et fixation interne des fractures graves du pion. J Orthop Trauma. 1999 ; 13(2):85-91. doi :10.1097/00005131-199902000-00003.
- White TO, Guy P, Cooke CJ, et al. Les résultats de la réduction ouverte primaire précoce et de la fixation interne pour le traitement des fractures du pilon tibial de type OTA 43.C : une étude de cohorte. J Orthop Traumatologie. 2010 ; 24(12):757-763. doi :10.1097/BOT.0B013E3181D04BC0.
- Shafiq B, Zhang B, Zhu D, et al. Réduire les complications dans la chirurgie de la fracture du pilon : le temps chirurgical compte. J Traumatisme orthop. 2023; 37(10):532-538. doi :10.1097/BOT.000000000002637.
- Tornetta P, Gorup J. Tomographie axiale des fractures du pilier. Clin Orthop Relat Res. 1996; 323(323):273-276. doi :10.1097/00003086-199602000-00037.
- Barei DP. Fractures du pilon tibial. Dans : Tornetta P, Ricci WM, Ostrum RF, McQueen MM, McKee MD, Court-Brown CM, eds. Fractures de Rockwood et Green chez les adultes. Neuvième édition. Wolters Kluwer ; 2020:2752-3060.
- Cinats DJ, Kooner S, Johal H. Clouage aigu de l’arrière-pied pour les fractures de la cheville : une revue systématique des indications et des résultats. J Traumatisme orthop. 2021; 35(11):584-590. doi :10.1097/BOT.000000000002096.
- Herscovici D, Sanders RW, Infante A, DiPasquale T. Incision de Bohler : une approche antérolatérale extensile du pied et de la cheville. J Traumatisme orthop. 2000; 14(6):429-432. doi :10.1097/00005131-200008000-00009.
- Assal M, Ray A, Stern R. Stratégies pour les approches chirurgicales dans la fixation interne de réduction ouverte des fractures du pilier. J Traumatisme orthop. 2015; 29(2):69-79. doi :10.1097/BOT.000000000000218.
- Howard JL, Agel J, Barei DP, Benirschke SK, Nork SE. Une étude prospective évaluant la mise en place de l’incision et la cicatrisation des plaies pour les fractures du plafond tibial. J Orthop Trauma. 2008 ; 22(5):299-305. doi :10.1097/BOT.0B013E318172C811.
- Gustilo RB, Anderson JT. Prévention de l’infection dans le traitement de mille vingt-cinq fractures ouvertes des os longs : analyses rétrospectives et prospectives. J Bone Joint Surg Am. 1976; 58(4) :453 à 458.
- Rodriguez L, Jung HS, Goulet JA, Cicalo A, Machado-Aranda DA, Napolitano LM. Protocole fondé sur des données probantes pour les antibiotiques prophylactiques dans les fractures ouvertes : amélioration de la gestion des antibiotiques sans augmentation des taux d’infection. J Trauma Acute Care Surg. 2014 ; 77(3):400-408. doi :10.1097/TA.000000000000398.
- Fitzgibbons PG, Di Giovanni C, Hares S, Akelman E. Utilisation sûre du garrot : un examen des preuves. J Am Acad Orthop Surg. 2012; 20(5):310-319. doi :10.5435/JAAOS-20-05-310.
- Pugh KJ, Wolinsky PR, McAndrew MP, Johnson KD. Fractures du pilon tibial : comparaison des méthodes de traitement. J Traumatisme. 1999 ; 47(5):937-941. doi :10.1097/00005373-199911000-00022.
- Harrison WD, Fortuin F, Durand-Hill M, Joubert E, Ferreira N. Fixation externe circulaire temporaire pour couvrir l’articulation de la cheville traumatisée : une étude de comparaison de cohorte. Blessure. 2022; 53(10):3525-3529. doi :10.1016/J.INJURY.2022.07.034.
- Lavini F, Dall’Oca C, Mezzari S, et al. Fixation externe de pontage temporaire dans la fracture tibiale distale. Blessure. 2014; 45 Suppl 6(S6) :S58-S63. doi :10.1016/J.INJURY.2014.10.025.
- Olson JJ, Anand K, Esposito JG, et al. Complications et couverture des tissus mous après des fractures articulaires complètes et ouvertes du plafond tibial. J Traumatisme orthop. 2021; 35(10) :E371 à E376. doi :10.1097/BOT.000000000002074.
- Flanagan CD, Lufrano RC, Mesa L, et al. Résultats après fixation aiguë par rapport à la fixation par étapes de fractures complètes du plafond tibial articulaire. J Traumatisme orthop. 2023; 37(6):294-298. doi :10.1097/BOT.000000000002572.
- Olson JJ, Anand K, von Keudell A, et al. L’utilisation judicieuse de la fixation précoce des fractures fermées et complètes du pilon articulaire n’est pas associée à un risque accru d’infection profonde ou de complications de la plaie. J Traumatisme orthop. 2021; 35(6):300-307. doi :10.1097/BOT.000000000001991.
- Kim YJ, Richard RD, Scott BL, Parry JA. Le protocole de fixation aiguë pour les fractures du pilon tibial à haute énergie réduit le temps de fixation et réduit les coûts opératoires sans affecter les complications et les réopérations de la plaie. J Orthop Traumatisme. 2023 ; 37(10):525-531. doi :10.1097/BOT.000000000002639.
Cite this article
Merchan N, Hresko AM, Rodriguez EK. Tibia gauche, pilon, fracture ouverte, réduction ouverte et fixation interne avec fixateur externe. J Med Insight. 2025; 2025(445). doi :10.24296/jomi/445.