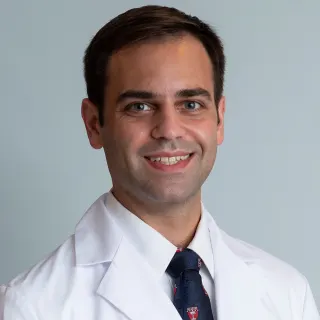Fracture oblique du tibia distal droit, réduction ouverte et fixation interne (ORIF) avec neutralisation médiale : plaque non verrouillable
Main Text
Table of Contents
Les fractures diaphysaires du tibia sont des blessures courantes qui sont le plus souvent traitées par clouage intramédullaire. Cependant, certains facteurs liés au patient peuvent nécessiter des stratégies de traitement alternatives telles que la fixation interne par réduction ouverte (ORIF) avec des plaques et des vis. La présence d’une arthroplastie totale du genou (ATG) dans l’extrémité blessée est l’un de ces facteurs. L’ATG est une opération courante qui ne fait que gagner en popularité, et la prise en charge des fractures du tibia distales à l’ATG peut être un scénario clinique fréquemment rencontré. Dans cette vidéo, nous présentons une technique d’ORIF d’une fracture diaphysaire distale du tibia distale distale à une ATG qui empêche la fixation intramédullaire de l’ongle. La fracture est réparée à l’aide de tire-fonds et sécurisée à l’aide d’une plaque de verrouillage-compression (LCP) distale du tibia distal anatomique en mode neutralisation.
Les fractures diaphysaires du tibia sont des blessures relativement courantes, survenant chez 21,5 personnes sur 100 000 et représentant 1,9 % de toutes les fractures chez les adultes.1 17 % de ces fractures surviennent chez des patients > 65 ans.1 Le clouage intramédullaire, la fixation interne à réduction ouverte (ORIF) avec des constructions à plaques et à vis et le moulage sont autant d’options de traitement viables.2 Le clouage intramédullaire alésé est l’intervention standard pour les fractures diaphysaires du tibia, car cette procédure implique une violation minimale des tissus mous tout en permettant d’obtenir des taux de consolidation fiables.3 Cependant, le choix du traitement peut être influencé par des facteurs spécifiques au patient. L’un de ces facteurs est la présence d’une arthroplastie totale du genou (ATG) dans la jambe blessée. Aux États-Unis, 7,3 % des adultes de plus de 70 ans ont subi une ATG, et la fréquence à laquelle cette opération est pratiquée devrait s’accélérer dans les années à venir.4,5 La présence d’un composant tibial ATK dans un tibia fracturé peut bloquer l’accès au point d’entrée idéal pour un clou intramédullaire et augmenter le risque de fracture du tubercule tibial iatrogène associée. Bien que le clouage intramédullaire sous un ATG soit une option bien décrite entre les mains de chirurgiens expérimentés lorsqu’il y a suffisamment d’espace vers l’avant, l’ORIF peut être une option préférable si la fracture du tibia doit être traitée chirurgicalement et qu’il y a trop peu d’espace pour accueillir un clou en toute sécurité.
L’anamnèse ciblée doit inclure l’âge et les antécédents médicaux du patient et permettre de comprendre le mécanisme de la blessure. Il est important d’obtenir des antécédents d’opérations antérieures sur l’extrémité blessée, telles que des implants chirurgicaux existants qui peuvent limiter les options chirurgicales pour traiter la blessure aiguë, et des cicatrices chirurgicales antérieures qui peuvent dicter l’emplacement des incisions prévues. Une attention particulière doit être accordée à l’état fonctionnel de base du patient, y compris la situation de vie à domicile et la dépendance aux appareils fonctionnels pour la mobilisation.
Dans ce cas, il s’agit d’une femme de 59 ans qui a subi une blessure par torsion à l’extrémité inférieure droite au cours d’un épisode présyncopal, après quoi elle a été incapable de supporter son poids. Ses antécédents médicaux sont significatifs pour des lésions cérébrales traumatiques, le diabète sucré de type 2, l’hypertension, la dépression et l’anxiété. Elle avait déjà subi une ATG droite plusieurs années avant de subir cette blessure. Elle vit seule et se déplace de manière autonome sans utiliser de déambulateur ou de canne.
Lors de l’évaluation initiale au service des urgences, le membre inférieur droit blessé a été placé dans une attelle de plâtre pour une longue jambe pour une stabilisation provisoire. Cette attelle utilise des dalles postérieures, médiales et latérales pour immobiliser le genou et la cheville tout en contrôlant la rotation du tibia fracturé.
Les éléments importants de l’examen physique comprennent l’évaluation des plaies ouvertes et une évaluation neurovasculaire détaillée. Les cicatrices chirurgicales existantes doivent être notées. Les fractures diaphysaires du tibia présentent un risque élevé de développer un syndrome des loges, et des examens en série doivent être effectués. La fermeté des compartiments musculaires antérieurs, latéraux et/ou postérieurs de la jambe, les paresthésies du pied et la douleur avec amplitude de mouvement passive des orteils sont des signes préoccupants de développement du syndrome des loges. Le syndrome des loges a été rapporté dans 11,5 % des fractures du tibia et est plus susceptible de survenir chez les patients plus jeunes de moins de 30 ans.6
Dans ce cas, les signes vitaux du patient étaient stables. Il y avait une déformation grossière de l’extrémité inférieure droite avec la cheville tournée vers l’extérieur par rapport au genou. Il n’y avait aucune blessure à la peau de l’extrémité. Les compartiments musculaires de la jambe étaient mous et compressibles à la palpation. Elle était capable de bouger tous les orteils sans douleur significative. La sensation était intacte dans les distributions des nerfs péroniers superficiels, péroniers profonds, tibiaux, suraux et saphènes du pied. Elle avait des pouls péroniers profonds et dorsaux palpables.
Des radiographies simples de l’ensemble du tibia et du péroné doivent être obtenues avant l’opération. L’extension des fractures spiralées ou obliques du 1/3 distal de la diaphyse tibiale dans la surface articulaire distale (également appelée plafond tibial) peut nécessiter une fixation supplémentaire et doit être évaluée à l’aide de radiographies antéropostérieures (AP), latérales et à mortaise (rotation oblique interne de 15 à 20°) de la cheville. Dans la plupart des cas, une tomodensitométrie (TDM) du fragment de fracture distale, y compris la surface articulaire, est effectuée pour évaluer l’extension intra-articulaire. Une série de résultats de TDM dans des fractures diaphysaires du tibia distales en spirale 1/3 a rapporté des fractures de la malléole postérieure dans 92,3 % des cas, dont 50 % n’étaient pas apparentes sur les radiographies simples. La fracture de la malléole postérieure est généralement associée spécifiquement à une fracture distale en spirale 1/3.7 Une série précédente basée sur des radiographies simples n’a identifié des fractures de la malléole postérieure que dans 3,8 % de toutes les fractures du tibia, tous modèles confondus.8
Les radiographies dans ce cas ont mis en évidence une fracture en spirale dans le 1/3 distal de la diaphyse tibiale, dans la région de la jonction méta-diaphysaire. L’extension de la ligne de fracture en spirale vers la surface articulaire tibiale distale était apparente sur des radiographies simples, et une TDM a donc été obtenue. La TDM a montré une extension de la ligne de fracture à la malléole postérieure sans déplacement.
Si elles ne sont pas traitées, les fractures diaphysaires du tibia présentent un risque élevé de non-consolidation ou de malunion qui causerait une douleur continue importante et une perte de mobilité. En raison de la position sous-cutanée du tibia, une fracture non traitée présenterait également un risque élevé de conversion en fracture ouverte ou importune. Pour ces raisons, les fractures diaphysaires du tibia nécessitent un traitement actif fermé ou ouvert dans presque tous les cas.
Historiquement, les fractures diaphysaires du tibia ont été traitées à la fois par une gestion fermée comprenant le moulage et l’attelle fonctionnelle et par des méthodes ouvertes telles que l’ORIF avec des constructions à plaques et vis et le clouage intramédullaire.
La prise en charge fermée non chirurgicale implique une réduction fermée initiale avec la mise en place d’une attelle de plâtre à longue jambe ou d’un plâtre en fibre de verre pendant 2 à 4 semaines, suivie d’une conversion en plâtre portant un tendon rotulien à jambe courte ou une attelle fonctionnelle qui est portée jusqu’à 10 à 12 semaines après la blessure.9 Les patients reviennent à la clinique toutes les 2 à 4 semaines pour des radiographies en série afin de confirmer le maintien de la réduction. Si l’alignement se déplace à un degré inacceptable, une intervention chirurgicale peut être indiquée. Aucune mise en charge n’est autorisée pendant plusieurs semaines jusqu’à ce qu’il y ait des signes de formation de callosités robustes.
Dans l’ORIF, une incision est pratiquée et une dissection est effectuée à travers les tissus mous pour exposer l’os fracturé. L’incision est centrée sur le site de la fracture et s’étend de plusieurs centimètres proximale et distale pour permettre une exposition adéquate. La surface tibiale médiale est sous-cutanée et peut être facilement exposée par une incision juste médiale à la crête tibiale ; Une incision est pratiquée à travers le derme et une dissection émoussée est utilisée pour exposer le périoste au site de la fracture. Des efforts doivent être faits pour préserver autant que possible l’intégrité périostée. La surface latérale du tibia est exposée en incisant le fascia crural juste à côté de la crête tibiale et en élevant la musculature du compartiment antérieur. Les fractures susceptibles d’une réduction anatomique sont réduites généralement à l’aide de plusieurs pinces de réduction pointues Weber et fixées à l’aide d’une construction à plaque et à vis. Des vis de 3,5 millimètres (mm) et/ou 2,7 mm peuvent être placées à l’aide de la technique du décalage pour maintenir la réduction et fournir une compression. Une plaque de verrouillage-compression (LCP) de 3,5 mm aux contours anatomiques est ensuite placée en mode neutralisation. La plaque doit être suffisamment longue pour enjamber la fracture et permettre au moins 3 vis (6 cortex de fixation) proximale et distale au site de la fracture. Chez les patients très minces, l’enveloppe des tissus mous sur le tibia médial peut être si mince que la plaque est très proéminente ou il peut y avoir trop de tension pour une fermeture sûre de l’incision ; Dans ces cas, une plaque peut également être placée sur la surface latérale sous la musculature du compartiment antérieur. De même, dans les blessures à haute énergie, les tissus mous médiaux peuvent être trop compromis pour permettre une fermeture en toute sécurité sous tension, un placage latéral peut être préféré. Dans les fractures comminutives qui nécessitent une réduction fonctionnelle, la réduction est obtenue par une combinaison de manipulation fermée et de serrage percutané, et un LCP de 3,5 mm est appliqué en mode pontage. Dans ce cas, la plaque peut être insérée de manière peu invasive à l’aide d’une petite incision à l’extrémité proximale ou distale, glissée extrapériostée et maintenue avec des vis placées par voie percutanée. Dans les deux cas, la jambe est attelée en postopératoire et la mise en charge est limitée pendant plusieurs semaines.
Les ongles intramédullaires sont insérés à travers de petites incisions autour du genou. Une réduction fonctionnelle est obtenue en utilisant une combinaison de manipulation fermée et de serrage percutané. Une goupille de guidage est utilisée pour identifier le point d’entrée idéal juste en milieu de la colonne tibiale latérale et juste en avant de la surface articulaire.9 Le canal est ensuite alésé séquentiellement pour permettre l’insertion d’un clou de taille suffisante, généralement de 9 à 11 mm de diamètre. L’ongle est fixé proximal et distalement avec des vis insérées à travers des incisions percutanées. La mise en charge immédiate est généralement autorisée après le clouage intramédullaire.
Les objectifs du traitement des fractures diaphysaires du tibia sont de restaurer la longueur fonctionnelle, l’alignement et la rotation de l’os fracturé afin de ramener le patient à une mobilité et une fonction précoces.
Chez ce déambulateur communautaire actif d’âge moyen, l’intervention chirurgicale a été indiquée pour minimiser le temps nécessaire à la mise en charge complète et optimiser l’alignement du membre blessé. La présence d’un ATG dans le tibia blessé a conduit à la décision d’ORIF avec une plaque et des vis sur un clou intramédullaire. Le motif de fracture oblique en spirale, relativement simple, permettait une réduction anatomique de la fracture qui pouvait être réparée à l’aide de tire-fonds et d’une plaque en mode neutralisation.
La présence d’un ATG dans l’extrémité blessée peut compliquer la pose d’un clou intramédullaire. Le clouage autour de la plaque de base tibiale est une technique avancée et ne peut être effectué en toute sécurité que lorsqu’il y a suffisamment d’espace entre la prothèse existante et le cortex antérieur.10 Les risques d’insertion d’un clou sont le déplacement de la prothèse ou la fracture iatrogène du tubercule tibial. S’il n’y a pas assez d’espace pour une insertion sûre des ongles, une ORIF doit être effectuée.
Les fractures diaphysaires du tibia sont des blessures courantes qui peuvent entraîner de graves limitations fonctionnelles si elles ne sont pas traitées de manière appropriée. Ces fractures peuvent être gérées de manière non chirurgicale par moulage en série et/ou contreventement fonctionnel, ou chirurgicalement par ORIF ou clouage intramédullaire. Dans la plupart des cas, ces fractures sont traitées chirurgicalement par clouage intramédullaire alésé, qui est la norme de soins.Cependant , certains facteurs du patient, tels que la présence d’un ATG avec un stock osseux antérieur limité, peuvent faire de l’ORIF une option privilégiée. Dans ce cas, nous avons réalisé une ORIF d’une fracture diaphysaire dibale du tibia distale à une ATG à l’aide d’une fixation par tire-fond avec une plaque de neutralisation médiale non verrouillable.
La prise en charge fermée et non chirurgicale des fractures diaphysaires du tibia peut être indiquée si le plâtre et l’attelle sont capables de maintenir des paramètres d’alignement stricts de longueur, d’alignement des plans coronal et sagittal et de rotation. Les paramètres acceptables précédemment cités sont l’angulation varus/valgus <5°, le procurvatum/recurvatum <5-10°, la rotation 0-10° et le raccourcissement <10-12 mm.9 L’alignement est initialement maintenu à l’aide d’une attelle en plâtre à longue jambe ou d’un plâtre en fibre de verre, suivi d’une période plus longue dans un plâtre ou une attelle fonctionnelle portant un tendon rotulien à jambe courte.9 Si l’alignement se déplace à tout moment en dehors des paramètres acceptables, la conversion en traitement opératoire est indiquée. La prise en charge non chirurgicale par ces méthodes peut être onéreuse pour les chirurgiens et les patients et a été associée à des taux accrus de non-consolidation (17 %) et de malunion (32 %) par rapport aux techniques chirurgicales.2 Pour ces raisons, la plupart des chirurgiens optent pour la prise en charge chirurgicale.11
L’ORIF et le clouage intramédullaire peuvent tous deux donner des résultats positifs. Les techniques modernes de placage utilisant des incisions de taille minimale, une manipulation soigneuse des tissus mous et des plaques de verrouillage à profil bas et anatomiques peuvent réduire le risque d’infection, de complications de la plaie et de décapage périosté qui peuvent contribuer au risque de non-union.12 L’ORIF nécessite une période d’attelle et de mise en charge non ou partielle immédiatement après l’opération. Les ongles intramédullaires sont insérés à travers des incisions relativement petites et entraînent moins de perturbation des tissus mous. La mise en charge immédiate telle que tolérée est généralement autorisée après la fixation intramédullaire, à moins qu’il n’y ait une extension de la fracture dans le plafond tibial. De nombreuses études ont comparé l’ORIF et le clouage intramédullaire pour les fractures du tibia diaphysaire, y compris plusieurs essais contrôlés randomisés (ECR). En ce qui concerne les fractures de la diaphyse tibiale distale en particulier, les études ont généralement montré des taux plus élevés de désalignement avec les ongles intramédullaires avec des taux similaires d’infection profonde et de non-consolidation.12 Les taux de désalignement des fractures du tibia distal se situent entre 8 et 50 % pour le clouage intramédullaire contre 0 à 17 % pour l’ORIF.12 L’infection profonde est relativement rare avec l’une ou l’autre opération (0 à 8 %).12 Les taux rapportés de non-consolidation sont similaires après le clouage intramédullaire et l’ORIF, entre 3 et 25 %, bien que certaines publications suggèrent une cicatrisation plus lente avec l’utilisation de plaques de verrouillage en particulier.12 Un ECR récent de grande envergure portant sur 258 fractures du tibia distal traitées chirurgicalement n’a révélé aucune différence dans l’invalidité autodéclarée ou la qualité de vie des patients entre l’ORIF et l’onglage intramédullaire à 12 mois postopératoires, bien que les patients ayant subi un clouage intramédullaire aient signalé une invalidité plus faible à 3 mois.13 De même, une étude de suivi menée à 5 ans après l’opération n’a révélé aucune différence dans les résultats rapportés par les patients ni dans les taux de réopération.14 Cette étude de suivi à long terme a également révélé que le niveau d’invalidité signalé par les patients n’avait pas changé après les 12 premiers mois suivant l’une ou l’autre opération.14
Les plaques pour ORIF peuvent être placées sur les surfaces médiales ou latérales du tibia. Le placage médial est pratique car le tibia sous-cutané est facilement accessible, tandis que l’exposition du tibia latéral pour le placage nécessite de soulever la musculature du compartiment antérieur. Bien que le placage latéral ouvert nécessite une dissection et une exposition plus importantes, l’enveloppe des tissus mous plus robuste protège également contre les complications de la plaie et la proéminence de la plaque, qui sont plus fréquentes avec le placage médial.15 S’il envisage un placage médial, le chirurgien doit examiner soigneusement l’épaisseur de la peau médiale et de la graisse sous-cutanée et doit prendre en considération les facteurs de l’hôte qui peuvent influencer la cicatrisation de la plaie, notamment l’âge, le diabète, l’obésité et le tabagisme.12 Des techniques de placage percutané peu invasives qui minimisent la taille des incisions et le décapage des tissus mous ont été décrites pour le tibia médial et latéral.
L’insertion d’un clou intramédullaire est plus compliquée lorsqu’il y a un ATG préalablement implanté dans l’extrémité blessée. Historiquement, les chirurgiens ont opté pour l’ORIF pour le traitement des fractures tibiales diaphysaires distales à un ATG par crainte de déplacer la plaque de base tibiale ou de provoquer une fracture tibiale du tubercule tibiale. Plus récemment, des techniques d’insertion d’un clou en présence d’une ATG ont été rapportées. En 2022, Shaath et al. ont signalé le clouage réussi de 9 fractures sans incidence de non-consolidation, d’infection ou de complications d’arthroplastie.10 Dans leur série, la distance moyenne entre la densité corticale du tubercule tibial et la quille de la composante tibiale TKA était de 24,1 mm, avec une distance minimale de 19,5 mm. Ils étaient capables d’insérer des clous jusqu’à 11 mm.10 Toujours en 2022, Stevens et al. ont signalé un clouage réussi avec un minimum de 14,8 mm entre l’implant et le cortex antérieur.16 Bien que ces séries montrent que le clouage intramédullaire peut réussir en présence d’un ATG, il s’agit d’une technique avancée qui nécessite un haut niveau de compétence en matière de clouage intramédullaire et une aisance à gérer les complications peropératoires potentielles si elles surviennent. Les conseils pour effectuer le clouage intramédullaire sous un TKA comprennent l’utilisation d’un fil Kirschner de 2,0 mm pour trouver le point de départ et sonder la trajectoire du clou, l’utilisation d’une vis de blocage postérieure distale du composant tibial TKA, le maintien de la trajectoire antérieure du fil-guide à pointe sphérique avec un poinçon canulé ou une pointe d’aspiration Yankauer, et le passage lent des alésoirs et du clou autour de la plaque de base TKA.10,16
Dans le cas décrit dans cette vidéo, on a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’espace pour le passage en toute sécurité d’un clou intramédullaire, car la distance entre la densité corticale du tubercule tibial et la quille du composant tibial TKA était de 16 mm. La fracture a été réduite par une incision antéromédiale et fixée à l’aide de deux tire-fonds de 3,5 mm. Un LCP de 3,5 mm a ensuite été appliqué sur la surface médiale du tibia. Il n’y a pas eu de déplacement du fragment de fracture de la malléole postérieure, et aucune fixation n’a été effectuée en raison de la petite taille du fragment et de l’attente que le patient ne serait pas porteur initialement après l’opération. La durée de l’opération était de 64 minutes et la perte de sang était de 100 millilitres.
L’évolution postopératoire du patient s’est déroulée sans complication. Elle a d’abord été placée dans une attelle en plâtre, qui a été transformée en une botte à mouvement contrôlé de la cheville (CAM) à 2 semaines postopératoires. Sa mise en charge a été avancée à 50 % à 6 semaines postopératoires, puis à la mise en charge complète tolérée à 12 semaines. Lors de son suivi le plus récent, 5 mois, elle avait une douleur minime avec une mise en charge complète et aucune limitation de l’amplitude de mouvement de la cheville par rapport au côté controlatéral non blessé, et sa fracture a été complètement guérie par radiographie.
- Plaques de verrouillage-compression tibiales distales profilées anatomiquement
- Pinces de réduction Weber de différentes tailles
- Vis de verrouillage et non verrouillables à petits fragments
References
- Court-Brown CM, Caesar B. Épidémiologie des fractures chez l’adulte : une revue. Blessure. 2006; 37(8):691-697. doi :10.1016/j.injury.2006.04.130.
- Coles CP, Gross M. Fractures de la diaphyse tibiale fermée : complications de gestion et de traitement. Une revue de la littérature prospective. Can J Surg. 2000 ; 43(4).
-
Étude visant à évaluer prospectivement les ongles intramédullaires alésés chez les patients souffrant de fractures du tibia Investigateurs ; Bhandari M, Guyatt G, Tornetta P 3rd, Schemitsch EH, Swiontkowski M, Sanders D, Walter SD. Essai randomisé de clouage intramédullaire alésé et non alésé des fractures de l’arbre tibial. J Bone Joint Surg Am. Décembre 2008 ; 90(12):2567-78. doi :10.2106/JBJS.G.01694.
- Kremers HM, Larson DR, Crowson CS, et al. Prévalence de l’arthroplastie totale de la hanche et du genou aux États-Unis. J Bone Jt Surg - Am Vol. 2014; 97(17):1386-1397. doi :10.2106/JBJS.N.01141.
- Shichman I, Askew N, Habibi A, et al. Projections et épidémiologie de l’arthroplastie de révision de la hanche et du genou aux États-Unis jusqu’à 2040-2060. JBJS en libre accès. 2023; 8(1) :e22.00112. doi :10.1016/j.artd.2023.101152.
- McQueen MM, Duckworth AD, Aitken SA, Sharma RA, Court-Brown CM. Prédicteurs du syndrome des loges après fracture du tibia. J Traumatisme orthop. 2015; 29(10):451-455. doi :10.1097/BOT.000000000000347.
- Sobol GL, Shaath MK, Reilly MC, Adams MR, Sirkin MS. L’incidence de l’atteinte de la malléole postérieure dans les fractures du tibia distal en spirale : est-elle plus élevée qu’on ne le pense ? J Orthop Trauma. 2018 ; 32(11):543-547. doi :10.1097/BOT.000000000001307.
- Stuermer EK, Stuermer KM. Fracture de la diaphyse tibiale et blessure à l’articulation de la cheville. J Traumatisme orthop. 2008; 22(2):107-112. doi :10.1097/BOT.0b013e31816080bd.
- Boulton C, O’Toole RV. Fractures du tibia et du péroné. Dans : Tornetta P, Ricci WM, Ostrum RF, McQueen MM, McKee MD, Court-Brown CM, eds. Fractures chez les adultes de Rockwood et Green, neuvième édition. Philadelphie, Pennsylvanie : Wolters Kluwer ; 2020:2687-2751.
- Shaath MK, Avilucea FR, Kerr M, et al. Le traitement des fractures tibiales diaphysaires distales à une arthroplastie totale du genou par clouage intramédullaire est sûr et efficace. J Traumatisme orthop. 2022; 36(12):639-642. doi :10.1097/BOT.000000000002438.
- Busse JW, Morton E, Lacchetti C, Guyatt GH, Bhandari M. Prise en charge actuelle des fractures de la diaphyse tibiale : une enquête menée auprès de 450 chirurgiens orthopédiques canadiens en traumatologie. Acta Orthop. 2008; 79(5):689-694. doi :10.1080/17453670810016722.
- Vallier, H.A. Preuves actuelles : plaque ou clou intramédullaire pour la fixation des fractures du tibia distal en 2016. J Orthop Trauma. 2016 ; 30(11) :S2 à S6. doi :10.1097/BOT.000000000000692.
- Costa ML, Achten J, Griffin J, et al. Effet de la fixation de la plaque de verrouillage par rapport à la fixation intramédullaire de l’ongle sur l’invalidité de 6 mois chez les adultes atteints d’une fracture déplacée du tibia distal : l’essai clinique randomisé britannique FixDT. JAMA. 2017; 318(18):1767-1776. doi :10.1001/JAMA.2017.16429.
- Parsons N, Achten J, Costa ML. Résultats à cinq ans pour les patients présentant une fracture déplacée du tibia distal. Articulation osseuse J. 2023; 105-B(7) :795-800. doi :10.1302/0301-620X.105B7.BJJ-2022-1419.R1.
- Kumar D, Mittal A, Singh J, et al. Plaques de compression à verrouillage antérolatéral et médial pour la prise en charge des fractures tibiales distales : une étude prospective comparative. Cureus. 2023; 15(8) :E44235. doi :10.7759/cureus.44235.
- Stevens NM, Tyler AF, Mitchell PM, Stinner DJ. Considérations préopératoires et peropératoires à l’aide de clous intramédullaires pour le traitement des fractures de la diaphyse tibiale sous l’arthroplastie totale du genou. J Orthop Traumatisme. 2022 ; 36(11) :e437 et e441. doi :10.1097/BOT.000000000002367.
Cite this article
Hresko AM, Rodriguez EK. Fracture oblique tibiale distale droite, réduction ouverte et fixation interne (ORIF) avec neutralisation médiale, plaque non verrouillable. J Med Insight. 2024; 2024(444). doi :10.24296/jomi/444.