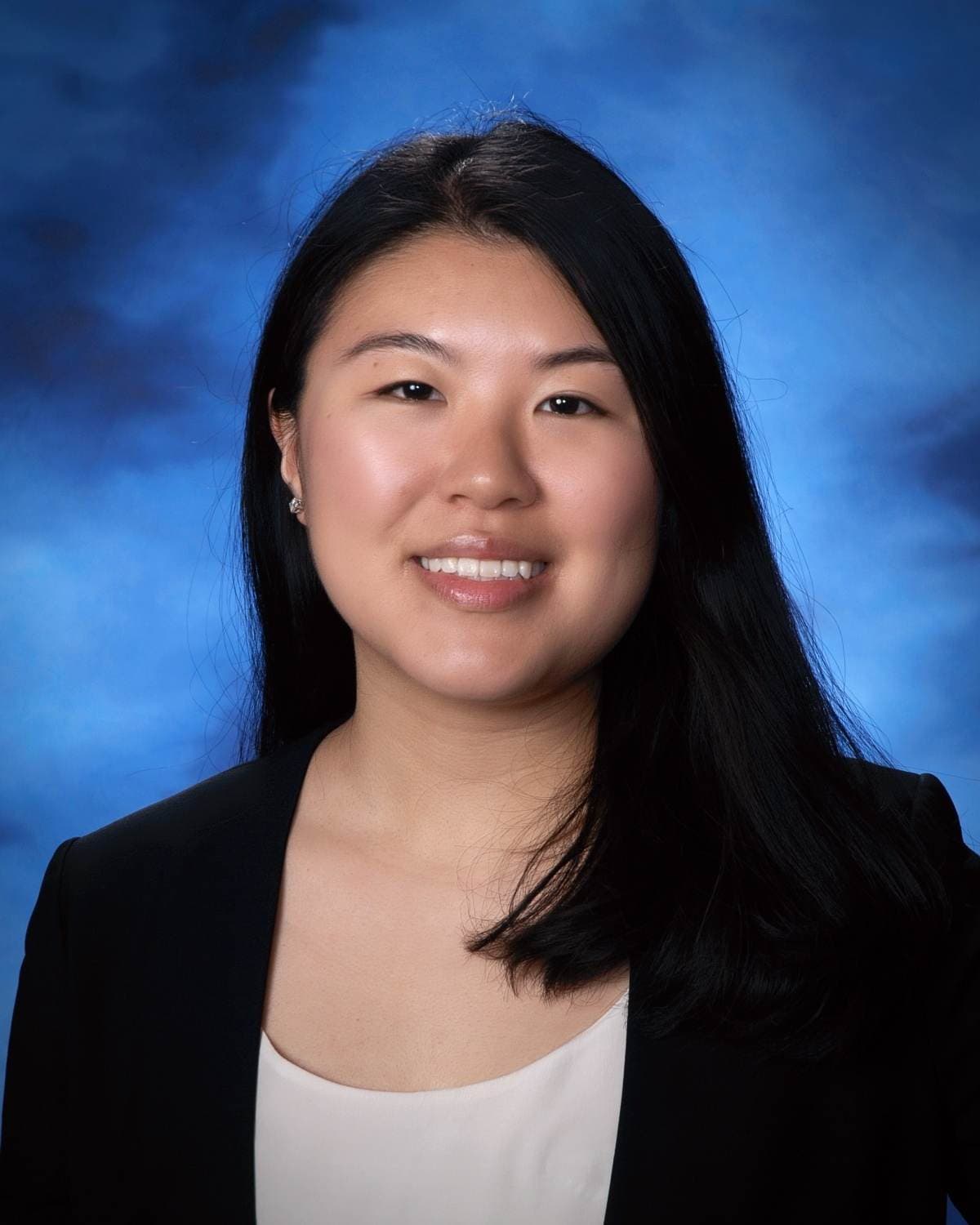Transposition sous-cutanée du nerf ulnaire
Main Text
Table of Contents
Le syndrome du tunnel cubital est l’une des neuropathies de compression les plus courantes affectant le membre supérieur. Les résultats de l’examen physique comprennent une perte de sensation, une faiblesse musculaire et des griffes des doigts. Les cas plus graves montrent également une atrophie musculaire irréversible, des contractures de la main et une perte de fonction. Il existe plusieurs approches pour traiter le syndrome du tunnel cubital. Ici, une transposition antérieure sous-cutanée a été réalisée sur ce patient. Le nerf ulnaire du patient s’est subluxé lors de la flexion et de l’extension du coude lors de l’examen physique, ce qui était une indication principale pour choisir cette approche chirurgicale par rapport à d’autres techniques. Cette procédure permet non seulement de décompresser le nerf affecté, mais aussi de transposer le nerf antérieur à l’épicondyle médial afin de soulager la tension sur le nerf sur toute l’amplitude de mouvement du coude.
Il s’agit du cas d’une femme de 42 ans présentant un engourdissement de l’annulaire et des petits doigts pendant plusieurs mois, ce qui est pire la nuit ou lorsqu’elle est assise sur une chaise. Au fil du temps, le patient note une sensibilité à l’intérieur du coude et une altération de la dextérité et de la force de la main.
Le syndrome du canal cubital est la deuxième neuropathie de compression la plus fréquente affectant le membre supérieur après le syndrome du canal carpien. 1 Il touche environ 1 % de la population générale aux États-Unis. Cependant, les informations sur l’épidémiologie du syndrome du canal cubital sont limitées par rapport à celles du syndrome du canal carpien. Contrairement au syndrome du canal carpien, la surveillance active du syndrome du canal cubital aux États-Unis fait défaut, ce qui a des implications pour l’établissement de directives standard sur son diagnostic et son traitement. 2 En plus d’affecter les activités de la vie quotidienne du patient, le syndrome du tunnel cubital représente également un fardeau économique supplémentaire. Dans une étude menée par Juratli et al., près de la moitié des travailleurs atteints de cette maladie ont reçu des prestations d’invalidité avant le diagnostic. 3
Le traitement de première intention du syndrome du tunnel cubital est généralement non opératoire. Cependant, lorsque le traitement conservateur ne parvient pas à soulager les symptômes, une intervention chirurgicale est nécessaire. Il existe une variété d’interventions chirurgicales différentes qui peuvent être effectuées. Ici, une transposition du nerf ulnaire sous-cutané antérieur est réalisée sur ce patient.
Les résultats de l’examen physique révéleront une diminution de la sensation dans l’annulaire et les petits doigts, ainsi qu’une faiblesse musculaire dans l’abdomen de la main. Dans les cas plus avancés, le griffage de l’annulaire et des petits doigts peut également être évident lors de l’inspection de la main. De plus, plusieurs tests peuvent être effectués sur la main pour aider au diagnostic du syndrome du tunnel cubital. Un signe de Froment positif se produit lorsque l’articulation interphalangienne du pouce du patient fléchit lorsqu’on lui demande de pincer un objet plat, tel qu’une feuille de papier. Un signe de Wartenberg positif montrera une abduction persistante du cinquième doigt lors d’une tentative d’adduction de tous les doigts. Enfin, des tests provocateurs tels que le signe de Tinel, où une légère percussion sur le nerf provoque une sensation de picotement, et la reproduction des symptômes lors de la flexion du coude, peuvent également être effectués pour étayer ce diagnostic.
Les patients atteints du syndrome du tunnel cubital présentent une gamme de symptômes tels que l’inconfort, la faiblesse musculaire et l’engourdissement de l’annulaire et des petits doigts. Les patients peuvent également signaler des symptômes nocturnes tels qu’un réveil dû au fait de dormir avec le coude en position fléchie. Les premiers symptômes sont principalement sensoriels, avec des changements moteurs survenant plus tard. Dans les cas plus graves, une perte de fonction, des contractures de la main et une atrophie musculaire irréversible peuvent également être évidentes si le patient n’est pas traité. 4
Les thérapies non chirurgicales telles que le soulagement de la douleur, la réduction de l’inflammation et la réadaptation fonctionnent pour les patients dans 50 % des cas. Il s’agit notamment des AINS, des injections de corticostéroïdes et des attelles d’extension nocturne, qui ont tous montré leur efficacité. D’autres mesures telles que les coudières, la physiothérapie et l’évitement des activités provocatrices peuvent également soulager les symptômes.
L’intervention chirurgicale n’est envisagée que lorsque les traitements conservateurs ne parviennent pas à traiter les symptômes du patient. Il existe une variété d’interventions chirurgicales différentes pour traiter le syndrome cubital. Parmi ceux-ci figurent la décompression du nerf ulnaire ouvert ou endoscopique, la transposition du nerf ulnaire et l’épicondylectomie médiale. La décompression simple et la transposition antérieure (sous-cutanée ou sous-musculaire) sont les traitements chirurgicaux les plus courants du syndrome du tunnel cubital. Cependant, il n’y a pas de consensus sur la détermination du traitement chirurgical le meilleur et optimal pour le syndrome du tunnel cubital. Ainsi, le choix de la procédure est souvent déterminé par une variété de facteurs différents : la gravité de la compression nerveuse, des facteurs non spécifiques du patient et la préférence du chirurgien. 1
Comme mentionné ci-dessus, il n’existe pas d’approche standard pour traiter chirurgicalement le syndrome du tunnel cubital. Cependant, la décompression in situ telle qu’une libération en tunnel cubital est généralement considérée comme le premier choix chirurgical. Cependant, lorsqu’il y a une instabilité du nerf cubital de base, la transposition peut être meilleure. Dans ce cas, il était évident, à l’examen physique, que le nerf ulnaire du patient s’était subluxé lors de la flexion et de l’extension du coude. Cette découverte clé était la principale indication pour effectuer une transposition du nerf ulnaire par rapport à une libération du tunnel cubital in situ .
Avant l’incision, les patients reçoivent généralement une anesthésie générale ou régionale et reçoivent une injection de Marcaine avec de l’épinéphrine pour minimiser les saignements et la douleur postopératoire. Lors de la dissection contondante au niveau du nerf ulnaire et du tunnel cubital, le nerf cutané antébrachial médial a d’abord été identifié et protégé tout au long de la procédure, car les lésions de ce nerf sont courantes avec cette approche. Les veines croisées dans le champ opératoire ont été cautérisées pour prévenir la formation d’hématomes et d’ecchymoses postopératoires.
La dissection du nerf ulnaire a commencé en arrière de l’épicondyle médial où le nerf est plus facilement mobilisé et identifié. Le nerf ulnaire a été mobilisé en relâchant son fascia d’abord distalement puis proximal, en prenant soin de ne pas blesser les vaisseaux et les nerfs environnants. Le septum intermusculaire a ensuite été identifié et mobilisé pour éviter toute tension excessive sur le nerf ulnaire lors de la transposition.
Le tunnel cubital a d’abord été fermé avant de transposer le nerf ulnaire afin d’éviter la subluxation ou la luxation. Afin de maintenir le nerf ulnaire dans une position transposée sous-cutanée antérieurement, une technique de suture de matelas a été utilisée pour fixer l’écharpe fasciale au lambeau de peau antérieur. La visualisation directe et la flexion du coude peuvent confirmer que l’écharpe fasciale est suffisamment sûre sans comprimer le nerf ulnaire.
La plaie a été lavée et fermée avec des sutures en couches. En postopératoire, une écharpe a été fournie pour la protection et le confort. Le patient a été capable d’étirer le bras et de reprendre immédiatement les activités de la vie quotidienne. Cependant, il a été conseillé au patient d’éviter toute activité intense pendant au moins 2 à 6 semaines postopératoires jusqu’à ce que la plaie soit complètement cicatrisée. Une fois l’écharpe retirée, la physiothérapie est généralement conseillée pour permettre toute l’amplitude de mouvement de l’articulation du coude.
Il y a peu de complications associées à la transposition antérieure du nerf ulnaire. Parmi ceux-ci figurent la sensibilité aux cicatrices, l’infection et le syndrome douloureux régional complexe. 6 Ces complications sont dues à la nature de la technique chirurgicale elle-même ; Par rapport à une simple décompression in situ , la transposition du nerf cubital nécessite une incision plus grande, une dissection plus étendue, une plus grande manipulation du nerf et l’ablation du système vasculaire environnant. Une autre complication courante de cette procédure est une lésion de la branche postérieure du nerf cutané antébrachial médial, qui peut entraîner un névrome douloureux, une hyperesthésie, une hyperalgésie autour du coude médial et des cicatrices douloureuses. 7
La meilleure technique chirurgicale pour le syndrome du tunnel cubital fait encore l’objet de débats. Par conséquent, le choix de l’intervention chirurgicale dépend en grande partie des préférences du chirurgien. La décompression simple du nerf cubital est l’une des approches chirurgicales les plus courantes et les plus simples du syndrome du tunnel cubital, et elle peut être effectuée à la fois ouvertement ou par endoscopie. L’épicondylectomie médiale est une technique moins courante, mais elle est indiquée lorsque des anomalies structurelles de l’anatomie sont évidentes.
La transposition antérieure du nerf cubital est une autre approche courante pour traiter le syndrome du tunnel cubital. Bien que le choix de la procédure dépende en grande partie des préférences du chirurgien, il existe un consensus général parmi les chirurgiens sur le fait que la transposition antérieure est indiquée lorsque le patient présente une subluxation du nerf à l’examen. Les études qui ont comparé la transposition du nerf cubital à la décompression in situ n’ont montré aucune différence statistique en ce qui concerne les résultats cliniques. Cependant, il convient de noter que la transposition du nerf cubital est associée à un nombre plus élevé de complications en raison de la nature et de l’étendue de sa dissection.
Il existe trois types de transposition du nerf ulnaire : sous-cutanée, intramusculaire et sous-musculaire. La transposition sous-cutanée a été introduite pour la première fois par Benjamin Curtis en 1898 et est considérée comme l’une des approches les plus courantes du syndrome du tunnel cubital. 8 Il est généralement conseillé de faire une transposition sous-cutanée sur les deux autres approches dans la mesure du possible. Cependant, s’il y a des cas d’instabilité nerveuse préopératoire excessive ou d’irritabilité ou de sensibilité nerveuse, une transposition intramusculaire ou sous-musculaire peut être la méthode préférée. Des études ont montré des résultats cliniques similaires entre les transpositions sous-musculaires et antérieures. Cependant, l’un des avantages de la transposition sous-musculaire est que le muscle offre une couche supplémentaire de protection sur le nerf ulnaire. Cela peut être particulièrement utile pour les patients qui ont relativement peu de tissu sous-cutané.
Équipement standard.
Rien à divulguer.
Le patient visé dans cet article vidéo a donné son consentement éclairé pour être filmé et est conscient que des informations et des images seront publiées en ligne.
References
- Yahya A, Malarkey AR, Eschbaugh RL, Bamberger HB. Tendances dans le traitement chirurgical du syndrome du tunnel cubital : une enquête auprès des membres de la Société américaine pour la chirurgie de la main. Main (N Y). 2018; 13(5):516-521. https://doi.org/10.1177/1558944717725377
- An TW, Evanoff BA, Boyer MI, Osei DA. La prévalence du syndrome du tunnel cubital : une étude transversale dans une cohorte métropolitaine américaine. J Bone Joint Surg Am. 2017; 99(5):408-416. https://doi.org/10.2106/JBJS.15.01162
- Adkinson JM, Zhong L, Aliu O, Chung KC. Traitement chirurgical du syndrome du tunnel cubital : tendances et influence des caractéristiques du patient et du chirurgien. J Hand Surg Am. 2015; 40(9):1824-1831. https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2015.05.009
- Palmer BA, Hughes TB. Syndrome du tunnel cubital. J Hand Surg Am. 2010; 35(1):153-163. https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2009.11.004
- Andrews K, Rowland A, Pranjal A, Ebraheim N. Syndrome du tunnel cubital : anatomie, présentation clinique et prise en charge. J Orthop. 2018; 15(3):832-836. Publié le 16 août 2018. https://doi.org/10.1016/j.jor.2018.08.010
- Saïd J, Van Nest D, Foltz C, Ilyas AM. Décompression in situ du nerf cubital cubital par rapport à la transposition pour le syndrome du tunnel cubital idiopathique : une méta-analyse mise à jour. J Micro-chirurgie de la main. 2019; 11(1):18-27. https://doi.org/10.1055/s-0038-1670928
- Kang HJ, Koh IH, Chun YM, Oh WT, Chung KH, Choi YR. Chirurgie basée sur la stabilité du nerf cubital pour le syndrome du tunnel cubital via une petite incision : une comparaison avec la transposition classique du nerf antérieur. J Orthop Surg Res. 2015;10:121. Publié le 6 août 2015. https://doi.org/10.1186/s13018-015-0267-8
- Carlton A, Khalid SI. Approches chirurgicales et leurs résultats dans le traitement du syndrome du tunnel cubital. Chirurgie frontale. 2018;5:48. Publié le 26 juillet 2018. https://doi.org/10.3389/fsurg.2018.00048
Cite this article
Phun J, Ilyas AM. Transposition du nerf ulnaire sous-cutané. J Med Insight. 2021; 2021(296). doi :10.24296/jomi/296.